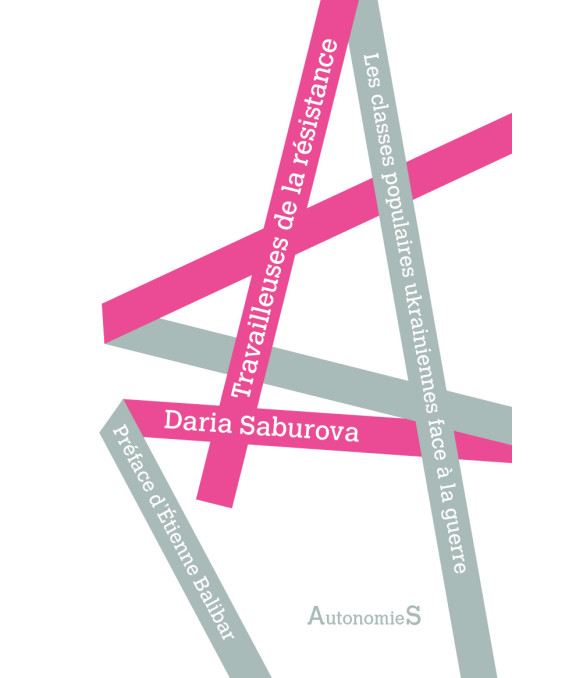« Il faut s’intéresser à la réalité complexe de la société ukrainienne »
Dans une enquête de terrain au sein d’organisations bénévoles, publiée en juin 2024, la philosophe Daria Saburova analyse comment se sont structurées les actions résistantes, trois ans après le début de l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
dans l’hebdo N° 1851 Acheter ce numéro

Daria Saburova a mené une enquête de terrain en Ukraine à Kryvyï Rih, ville natale de Volodymyr Zelensky, majoritairement russophone avant l’invasion, pour comprendre les ressorts de la résistance à partir du 24 février 2022. Son travail (1), qui s’intéresse au vécu des populations, met en exergue le rôle du genre et de la classe dans le travail de résistance réalisé par les bénévoles.
Travailleuses de la résistance. Les classes populaires ukrainiennes face à la guerre, Daria Saburova, Éditions du Croquant, 2024.
Les personnes que vous avez interrogées étaient majoritairement opposées au soulèvement de Maïdan en 2014, qui a abouti à la destitution du président pro-russe Viktor Ianoukovitch. Qu’est-ce qui les a poussées à entrer en résistance en février 2022 ?
Daria Saburova : En 2013-2014, sur la place de Maïdan, puis dans la guerre dans le Donbass, ce sont surtout les classes moyennes qui se sont mobilisées en tant que bénévoles et combattants volontaires. Elles formaient le noyau de cette mobilisation sur le plan organisationnel et idéologique. Pour elles, il s’agissait d’un combat pour l’État ukrainien indépendant, ainsi que pour la voie européenne et démocratique opposée à l’autoritarisme russe. Le renversement du pouvoir pro-russe de plus en plus autoritaire était justifié à leurs yeux.
Beaucoup de mes interlocuteurs et interlocutrices de Kryvyï Rih voyaient, au contraire, ces événements comme une atteinte à la démocratie de la part des manifestants et des partis d’opposition. La guerre dans le Donbass n’était pas leur guerre, alors même que certains de leurs collègues dans les mines et les usines se faisaient déjà mobiliser dans l’armée ukrainienne à ce moment-là. Mais le 24 février 2022, les gens se sont levés parce que leur ville, c’est-à-dire leur survie, leur existence matérielle et celle de leur communauté, était immédiatement menacée par une invasion militaire. Il s’agissait moins d’un engagement pour des valeurs abstraites qu’une défense de leur quotidien.
En quoi le rôle des bénévoles est-il devenu central dans la résistance à la Russie depuis 2014 ?
La guerre dans le Donbass avait déjà fait plus d’un million de déplacés internes, pris en charge principalement par les bénévoles (évacuation, logement, soutien administratif, soutien juridique, etc.), parce que l’aide fournie par l’État était largement insuffisante. En 2022, l’afflux de l’aide humanitaire était plus important, mais les problèmes structurels ont demeuré, et le bénévolat est devenu indispensable pour la distribution de cette aide.
Dans mon livre, j’explique que cette situation n’est pas uniquement le résultat d’une crise imprévisible, mais qu’elle est aussi en grande partie organisée par l’État (à travers les réformes néolibérales des services publics, qui se sont accélérées depuis 2014) et les organisations internationales (qui préfèrent coopérer avec les ONG privées). Le travail qui pourrait être effectué par les travailleurs des services publics est pris en charge gratuitement par les bénévoles. L’arrêt récent de l’USaid illustre les ravages de « l’ONG-nisation » de tels services : du jour au lendemain, cette décision de Trump a privé de financement des centaines de programmes dans le monde entier, y compris en Ukraine.
Est-ce que depuis votre premier travail d’enquête, en 2023, vous avez observé une démobilisation des bénévoles, ou une sorte de lassitude ?
Contrairement aux ONG « professionnelles », les organisations des classes populaires que j’ai suivies reposent largement sur le soutien de leur communauté. Par exemple, elles demandent aux voisins de leur apporter des ingrédients pour préparer des repas pour les soldats. Aujourd’hui, il est plus difficile de récolter des dons qu’avant. Il y a une certaine fatigue par rapport à la guerre. Mais, surtout, les classes populaires sont très affectées matériellement par la guerre et les politiques néolibérales du gouvernement.
Par exemple, dans certaines mines, les salaires ont baissé de 70 % depuis 2022. Le management justifie ces baisses par l’augmentation des coûts de production et les difficultés à trouver des débouchés sur le marché à cause de la guerre. Il est aidé en cela par la loi martiale : les mineurs ne peuvent pas faire grève et acceptent de travailler dans n’importe quelles conditions pour bénéficier de l’exemption de l’armée, car ces mines ont le statut d’entreprise stratégique.
En quoi ce travail bénévole est-il marqué par des dominations de genre et de classe ?
Il est évident que le monde du bénévolat est structuré par des logiques sociales de domination et d’exploitation. La plupart des fonds alloués par des organismes humanitaires internationaux vont aux organisations gérées par les classes moyennes et supérieures, les bénévoles des classes populaires étant quant à eux très peu dotés de ressources, alors qu’ils effectuent les missions les plus dangereuses et les plus physiques, en allant notamment apporter du matériel ou de la nourriture sur le front. Pour accéder aux ressources, ils dépendent des ONG « professionnelles ».
Dans les classes populaires, le bénévolat reste toujours du travail gratuit, alors que les ONG professionnelles allouent généralement une partie de leurs fonds aux salaires. Pour ce qui est du genre, il y a bien sûr les tâches traditionnellement perçues comme masculines, associée à la « masculinité héroïque », comme l’évacuation des civils de zones bombardées, mais la plupart du travail bénévole, c’est du travail reproductif que notre société assigne aux femmes : préparer des repas pour les réfugiés ou les soldats, faire du soutien psychologique, organiser des activités pour les enfants.
Le bénévolat prolonge la division sexuelle du travail.
La plupart des bénévoles de classes populaires que j’ai rencontrés étaient des femmes qui effectuaient des tâches très semblables à celles qu’elles effectuent dans le cadre domestique ou à celles réalisées par des femmes dans le secteur public. Le bénévolat prolonge cette division sexuelle du travail. Plus l’État adopte des réformes néolibérales dans le secteur public (éducation, santé, services sociaux) qui impliquent la suppression des postes et la baisse des salaires, plus les organisations de bénévoles vont devoir prendre en charge ces tâches-là.
Dans ce contexte de réformes néolibérales, comment a évolué le rapport de ces bénévoles et des syndicats à l’État ?
En 2022, le soutien de la population ukrainienne vis-à-vis de l’État et de certaines institutions comme l’armée était énorme. Zelensky était perçu comme le chef charismatique de la résistance. Cela ne veut pas dire qu’on soutenait toutes les initiatives du gouvernement, loin de là. La position des syndicats consistait par exemple à émettre des désaccords avec les actions du gouvernement, notamment avec les modifications du code du travail, sans pour autant s’engager dans une lutte sociale frontale, à la fois parce que la loi martiale interdit les grèves et les manifestations, mais aussi parсe que l’insécurité matérielle des travailleurs risquait de rendre toute grève impopulaire.
Les tensions sociales reviennent, et des contestations émergent, notamment autour de la mobilisation.
Jusqu’au début 2023, il y avait cette forte unité derrière l’État mais les tensions sociales reviennent, et des contestations émergent, notamment autour de la mobilisation. Depuis au moins un an, les services de recrutement appliquent des stratégies très dures, en arrêtant des gens dans la rue et en les amenant de force dans les commissariats, où l’examen médical devient une pure formalité avant l’envoi des nouvelles recrues dans les centres d’entraînement.
L’échec de cette stratégie de recrutement, ainsi que l’échec d’assurer une rotation pour les soldats mobilisés depuis trois ans, est évident quand on voit que le nombre de déserteurs dans l’armée ukrainienne s’élève à au moins 100 000 personnes. Mais ça ne veut pas dire que les gens ont massivement abandonné la cause de la résistance : les personnes qui esquivent l’enrôlement militaire soutiennent souvent l’armée à l’arrière.
Selon vous, quels sont les obstacles que nous avons en France pour comprendre correctement ce qui se joue en Ukraine ?
Au-delà de l’attention prêtée à la diplomatie et aux événements sur le front, il faut s’intéresser à ce qui se passe concrètement dans la société. Dans un champ politique de plus en plus polarisé sur la question ukrainienne, il faut avoir le courage de rester au contact du réel. Par rapport à la mobilisation militaire, par exemple, certains tentent de minimiser la violence faite aux hommes ukrainiens parce qu’ils craignent que la dénonciation des pratiques de recrutement ne sape le soutien à la résistance ukrainienne.
Au contraire, d’autres vont mettre l’accent sur ces violences pour nous faire croire que les Ukrainiens ne veulent plus résister, ou qu’ils accepteraient n’importe quelles conditions d’un cessez-le-feu, aussi fragile soit-il. La réalité est bien plus complexe. Il faut être prêt à voir les contradictions pour ce qu’elles sont, à considérer les fins détails de la situation des gens au lieu de s’accrocher superficiellement à des faits qui nous conviennent pour prouver tel ou tel point politique.
En France, on a lu beaucoup d’articles sur les Ukrainiens qui arrêtaient de parler russe et apprenaient l’ukrainien. Ce n’est pas forcément une pratique que vous avez retrouvée chez vos interlocuteurs et interlocutrices de Kryvyï Rih opposés à l’invasion russe. Quelles résistances existe-t-il par rapport à cette nouvelle norme ?
L’Ukraine est un pays multilingue. La question qui m’intéresse est de savoir si ce multilinguisme peut toujours exister dans les conditions de la guerre et même après la guerre. Pour esquisser des réponses, je me suis tournée vers ces classes populaires de villes réputées russophones comme Kryvyï Rih pour comprendre ce qu’elles pensent de ces processus, et quelles sont leurs pratiques linguistiques concrètes. Alors qu’à Kyiv, dans les classes moyennes et supérieures, les gens ont embrassé cette idée d’unification du pays autour de la langue ukrainienne, à Kryvyï Rih, j’ai observé une forme de résistance à la nouvelle norme monolinguistique.
Ce n’est pas une résistance publique et organisée, elle relève plutôt de stratégies de sabotage individuelles, qui impliquent la distinction entre « le texte public » et le « texte caché », pour parler comme James C. Scott. Par exemple, on va s’exprimer en ukrainien sur les réseaux sociaux et parler russe dans l’espace privé. Dans les entretiens, mes interlocuteurs défendent pour la plupart leur droit de continuer à parler la langue qu’ils veulent dans l’espace privé.
Les références à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale sont constantes dans le narratif russe pour justifier l’invasion de l’Ukraine. Chez les personnes que vous avez rencontrées à Kryvyï Rih, dont la plupart ont de la famille en Russie, quel est le rapport à cette histoire ?
Il y a une référence récurrente à la Seconde Guerre mondiale dans la rhétorique officielle russe : l’invasion russe de l’Ukraine serait la répétition de cette lutte contre les fascistes, puisque Poutine ne cesse de qualifier le gouvernement ukrainien de nazi. En réponse à cela, les élites intellectuelles et politiques ont adopté la voie de la « décommunisation » du pays, qui vise à défaire l’espace public et les discours de mémoire nationale des références à l’URSS. Cela est problématique parce que l’Ukraine, en tant que république soviétique, a joué un rôle immense dans la résistance de l’Union soviétique contre l’invasion fasciste. Chez mes interlocuteurs et interlocutrices à Kryvyï Rih, c’est pourtant très clairement la mémoire de la résistance soviétique au fascisme qui est mobilisée aujourd’hui pour donner de l’élan à la résistance contre l’invasion russe.
L’Ukraine et la Palestine se retrouvent aujourd’hui au cœur d’une reconfiguration majeure de l’ordre mondial.
Finalement, pourquoi les mouvements qui se réclament de l’émancipation, comme les partis de gauche ou les mouvements féministes, devraient être préoccupés par ce qui se passe en Ukraine ?
L’écrasement militaire et économique de l’Ukraine préparé conjointement par les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine révèle la capacité des extrêmes droites à sceller des alliances tactiques par-delà les partages géopolitiques qui fournissaient à la gauche des repères essentiels. Force est de reconnaître que l’Ukraine et la Palestine se retrouvent aujourd’hui au cœur d’une reconfiguration majeure de l’ordre mondial par les régimes réactionnaires, qui balayent d’un revers de la main à la fois le droit international et les avancées politiques et sociales héritées de la résistance antifasciste, des mouvements ouvriers, féministes et anticoloniaux de la seconde moitié du XXe siècle.
Les ruines de Gaza et celles des dizaines de villes dans l’est de l’Ukraine sont les signes les plus visibles de ce nouveau monde. Et tandis que la vie politique ukrainienne sous la loi martiale est elle-même marquée par le renforcement des tendances autoritaires et nationalistes, les forces progressistes en Ukraine méritent d’autant plus notre soutien.
Pour aller plus loin…

Portfolio : À Jinba, en Cisjordanie occupée, une vie rythmée par les attaques de colons

En Cisjordanie occupée, la vie clandestine des habitants de Jinba

« Les Démocrates ne reprendront pas le pouvoir à Trump sans livrer bataille »