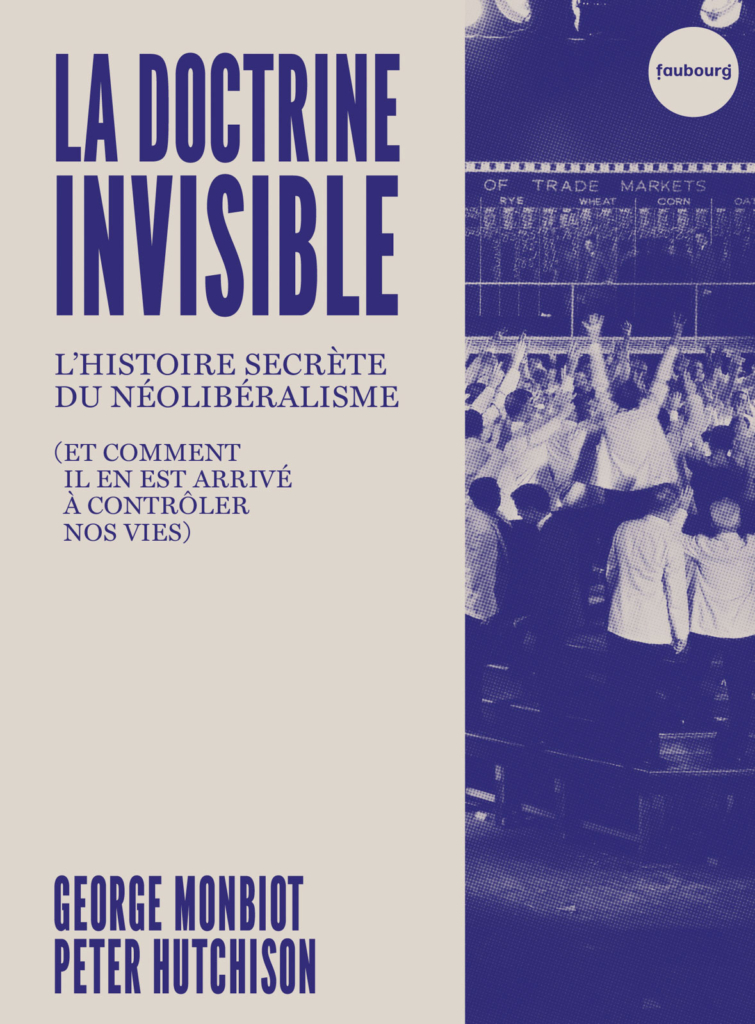George Monbiot : « Après l’hégémonie culturelle néolibérale, nous risquons celle du fascisme »
Journaliste, activiste écolo et enseignant à l’université d’Oxford, George Monbiot publie, avec le réalisateur de documentaires Peter Hutchison, un réquisitoire implacable sur l’hégémonie culturelle et l’organisation du capitalisme néolibéral.
dans l’hebdo N° 1855 Acheter ce numéro

© Maxime Sirvins
La Doctrine invisible. L’histoire secrète du néolibéralisme (et comment il en est arrivé à contrôler nos vies), George Monbiot & Peter Hutchison, traduit de l’anglais par Mathilde Ramadier, Éditions du Faubourg, 256 pages, 21 euros.
Né en 1963 à Londres, George Monbiot est diplômé de zoologie. Après avoir produit des documentaires radiophoniques sur la vie sauvage pour la BBC, il devient journaliste d’investigation indépendant. Il mène diverses enquêtes à travers le monde qui nourrissent son engagement pour la défense de l’environnement. Éditorialiste au quotidien The Guardian, il enseigne également à l’université d’Oxford.
Vous commencez La Doctrine invisible en cherchant à donner une définition du néolibéralisme, que vous qualifiez de théorie économique « anonyme ». Pourquoi ?
George Monbiot : Pour commencer, les gens qui ont formulé les principes du néolibéralisme ont compris que, politiquement, il fallait convaincre l’opinion, ou donner l’impression qu’ils ne faisaient que décrire l’ordre naturel des choses, qu’il ne s’agissait pas d’une philosophie mais simplement de la façon dont le monde fonctionne. Comme si ce n’était qu’une description objective du monde. C’est pourquoi ils ont toujours plus ou moins dissimulé leurs associations, leurs think tanks, et cela jusqu’à aujourd’hui. Par conséquent, on ne voit pas comment tout cela est coordonné, qu’il s’agit d’un programme concerté, d’une idéologie tout à fait délibérée et clairement formulée et construite.
C’est pourquoi vous parlez d’une « Internationale néolibérale ». Selon vous, l’un des plus grands succès de ses initiateurs est d’avoir réussi à conquérir idéologiquement les gauches des pays dits développés, jadis keynésiennes, au cours des années 1980. Comment y sont-ils parvenus ? Notamment, comment ont-ils fait en sorte qu’une large partie de la gauche se détache des questions sociales pour se préoccuper du seul marché ?
C’est une question centrale. Certaines idées qui dominent le débat politique parviennent à devenir hégémoniques et submergent l’état d’esprit des populations, jusqu’à donner l’impression qu’il n’y a pas d’alternative. C’est le fameux « There is no alternative » lancé par Margaret Thatcher. Elle l’a asséné si souvent que c’est même devenu un acronyme : « Tina » ! Mais elle n’avait presque plus besoin de le dire puisque, lorsque c’est la seule histoire que l’on vous répète sans fin, constamment rappelée par les médias et les politiques, vous finissez par oublier comment faire autrement et comment vous organiser autrement.
Ce manque d’alternative politique finit par devenir un manque d’imagination ! Autrefois, Richard Nixon a dit : « Nous sommes tous devenus keynésiens. » Cela traduisait alors le fait que la social-démocratie était vraiment devenue hégémonique, culturellement et idéologiquement. Mais, aujourd’hui, c’est le néolibéralisme qui est devenu hégémonique. Et il se pourrait bien – malheureusement – que le fascisme soit en train de le devenir désormais !
Lorsque vous revenez sur le développement du capitalisme, vous en précisez la définition. Quelle est la spécificité de ce système économique ?
Tout d’abord, il faut dire qu’il y a très souvent une confusion sur ce qu’est le capitalisme. La plupart des gens pensent que c’est simplement le commerce – acheter et vendre des choses. Or le commerce existe depuis des milliers d’années, avec des centaines de façons de le pratiquer. Le capitalisme n’est pas le commerce. C’est même son contraire. Quand on pense au marché, on pense d’abord à un lieu dans la rue où des gens vous proposent des biens à acheter : on est là dans une égalité de relation entre vous qui achetez et le commerçant qui vend. Et vous pouvez décider d’acheter à tel commerçant plutôt qu’à tel autre, notamment parce que ses produits sont moins chers. Mais ce n’est pas le capitalisme !
Le capitalisme est un système d’exploitation économique fondé sur le pillage colonial.
Le capitalisme est un système d’exploitation économique fondé sur le pillage colonial, dont le modus operandi est de s’emparer – par la violence – des ressources communes ou partagées, puis de les privatiser et de les accumuler. Et, en faisant cela, il cherche constamment à créer de nouvelles frontières pour leur exploitation. L’une des définitions les plus utiles, selon moi, du capitalisme et de son avènement est celle qu’a donnée Karl Polanyi (1) : la co-modification simultanée de la terre (du foncier), du travail (de la main-d’œuvre) et de la monnaie. C’est-à-dire ses trois piliers économiques fondamentaux.
Célèbre économiste progressiste d’origine hongroise, auteur notamment de La Grande Transformation (1944, réédité par Gallimard, coll. « Tel », 2009).
Vous soulignez que le capitalisme a toujours été lié au colonialisme. Le colonialisme est-il une racine constante et indissociable du développement capitalistique ?
Si l’on se rapporte aux travaux de Jason W. Moore (2), il se pourrait bien que le premier endroit où cela s’est produit fût l’île de Madère. Elle était inhabitée (l’un des rares exemples de ce point de vue) et les Portugais s’y établirent en 1420, totalement libres, donc, d’agir à leur guise sur cette terre afin que cela leur rapporte le plus d’argent possible. C’est une histoire emblématique. Les Portugais ont vite compris que l’endroit était propice à la production de sucre, mais il leur fallait de la main-d’œuvre : où la trouver ? Faudrait-il la payer ? Non, il suffisait d’aller rafler des esclaves ! Où ? D’abord aux Canaries, puis en Afrique de l’Ouest.
Historien, sociologue et géographe de l’environnement, enseignant à l’université de l’État de New York, auteur notamment de l’essai Le Capitalisme dans la toile de la vie. Écologie et accumulation du Capital, éd. Asymétrie, 2020.
L’esclavage est bien sûr la modification ultime du rapport de travail. Ensuite, ils avaient besoin d’argent pour financer tout cela. S’ils s’étaient tournés vers le Portugal, le roi ou les gentilshommes du pays, ils auraient dû acquitter des taux d’intérêt très élevés. Mais, étant loin du Portugal, ils pouvaient aller chercher des capitaux où ils voulaient, surtout là où les taux étaient les plus bas. Ils se rendirent donc à Gênes, où les prêts des banques étaient alors les plus avantageux. Madère est donc sans doute le lieu où les trois modifications dont je parlais ont eu lieu simultanément.
Le résultat fut la création d’un système économique entièrement nouveau et hyper productif. Madère devint la première productrice de sucre au monde, ce qui est remarquable pour une petite île. Mais, au bout d’à peine vingt ans, l’industrie s’est effondrée car l’île a rapidement manqué de bois, alors que c’était l’une de ses principales ressources naturelles. L’ensemble des forêts avait été détruit et consommé. Il fallait en effet environ 60 kg de bois pour chauffer et raffiner 1 kg de sucre.
Le taux de productivité s’est donc écroulé. Et là, caractéristique fondamentale de l’économie capitaliste, les producteurs de sucre ont fait un choix qu’ils n’auraient jamais fait au Portugal, où ils auraient décidé de changer d’activité : ils se sont dit que Madère, c’était fini, et sont simplement partis ailleurs. Ils ont recommencé à peu près la même opération à São Tomé et Principe, consommant bientôt toute la forêt de cet archipel. Après la découverte de l’Amérique, les Portugais sont partis au Brésil pour installer des plantations de sucre à une bien plus grande échelle, toujours en exploitant le maximum de ressources naturelles.
Cette fois, il y avait des habitants sur place, mais ils se sont dit qu’ils pouvaient faire la même chose qu’à Madère, en les réduisant en esclavage ou bien en les tuant si on ne pouvait pas les faire travailler. Ils ont donc brûlé une bonne partie des forêts et tué de nombreux représentants des peuples autochtones – puis fait venir, comme on le sait, des esclaves d’Afrique. Et ils sont remontés toujours plus au nord, jusqu’aux Caraïbes, bientôt imités par d’autres Européens – Espagnols, Néerlandais, Français ou Anglais – animés du même désir d’enrichissement. Les frontières du capitalisme se sont donc étendues toujours plus, avec une pression toujours accrue sur les écosystèmes.
En plus d’étendre ses frontières, le capitalisme est donc fondé sur une croissance constante. Mais il se fonde aussi sur l’ignorance perpétuelle des externalités de son développement, notamment de la pollution qu’il produit invariablement.
Ce que fait le capitalisme consiste d’abord à créer un espace sûr et protégé pour ses bénéficiaires, où l’on ne voit pas les dégâts qu’il entraîne, ni ce qui a été nécessaire pour produire. Cet espace sûr est valorisé par le marketing, la publicité, mais il est en général protégé des migrants qui pourraient vouloir s’y installer parce que vous avez détruit ou appauvri leurs pays d’origine. Et il est surtout très protégé des conséquences de l’exploitation que vous-même exercez. En dehors de ce cadre, nombre d’horreurs sont commises, et le travail des médias dominants est justement de ne pas les faire connaître, afin qu’il soit possible de continuer à bien vivre dans cet espace.
Il faut donc masquer la pollution, la dévastation des espaces naturels, la ruine de communautés autochtones entières. Pourtant, cela ne fonctionne jamais parfaitement. Les mégafeux en Californie, à Hollywood même, ont montré que même les super-riches peuvent être touchés et voir leurs immenses villas détruites ! Mais ils continuent de penser qu’ils vont s’en sortir en se réfugiant dans des bunkers ou en s’installant sur Mars…
Le capitalisme et le libéralisme ont toujours été limités par l’État ou les puissances publiques. Les néolibéraux ont décidé, eux, de mettre l’État à leur service, ou au service du marché. Diriez-vous que c’est là la définition du néolibéralisme ?
Je dirais que leur problème n’est pas tant l’État que le fait que les gens votent, ce qui est un grand problème pour le capital. Car, quand les gens votent, ils se mettent à demander des choses scandaleuses comme de meilleurs salaires, une réduction du temps de travail, des week-ends et des vacances, un bon système de santé et d’éducation et des services publics ! Le capitalisme a trouvé deux moyens de résoudre ce problème. L’un est le fascisme, très efficace contre la démocratie. Mais, en 1945, le fascisme a été défait militairement. Il a donc fallu trouver autre chose pour écraser les vraies aspirations démocratiques.
Face au récit de l’Internationale néolibérale (…) les citoyens et la gauche keynésienne ont été pris au dépourvu.
C’est alors que Friedrich Hayek a lancé le néolibéralisme avec son livre La Route de la servitude, qui pourtant se présentait comme une tentative de sauver la démocratie du totalitarisme. Les personnes les plus riches de la planète se sont enthousiasmées, se disant qu’elles avaient là une idéologie capable d’écraser la démocratie sans avoir recours au fascisme puisqu’il était discrédité après la guerre ! Et elles ont commencé à donner de l’argent à des think tanks promouvant le néolibéralisme, notamment le tout premier, la Société du Mont-Pèlerin (créée en 1947), puis d’autres, des instituts de recherche, et à financer des médias en leur faveur. Elles ont ainsi construit ce qui peut être appelé une « Internationale néolibérale ».
Ces très riches étaient tous très intelligents et ils ont été très malins : ils ont pris leur temps, ayant appris beaucoup de la gauche dans sa propagande en direction des masses. Milton Friedman, économiste et leader de la très néolibérale École de Chicago, disait d’ailleurs qu’il leur faudrait sans doute attendre le temps d’une génération pour que l’opinion soit « mûre » mais que, lorsque ce serait le cas, ils seraient prêts. Et c’est ce qui s’est produit ! Durant les Trente Glorieuses – comme vous les appelez en France –, le keynésianisme était hégémonique et semblait d’une solidité à toute épreuve.
Mais le capitalisme avait déjà trouvé la voie vers une globalisation de l’économie, une dérégulation du système monétaire et des changes. En somme, la voie pour détruire le keynésianisme hégémonique et le mettre en crise. Les néolibéraux étaient prêts et ont imposé non pas une idéologie mais d’abord un récit – qui aurait semblé scandaleux quelques années auparavant – apparaissant comme le sens commun et énonçant de prétendues évidences. Face à ce récit de l’Internationale néolibérale, désormais bien structurée et organisée, les citoyens, et la gauche keynésienne en premier lieu, ont été pris au dépourvu. Margaret Thatcher puis Ronald Reagan l’ont repris et mis en pratique une fois arrivés au pouvoir.
Mais pourquoi les électeurs de leurs pays ont-ils voté pour eux, alors que leurs idées pouvaient sembler si scandaleuses ?
Leur grande réussite a été d’imposer leur récit. La seule chose qui peut remplacer une histoire est une histoire. Le récit keynésien était en crise et le récit néolibéral, bien préparé, s’est imposé dans l’opinion sans difficultés, expliquant la situation du moment, vers où aller et comment. Ce récit avait été très travaillé, pour le rendre le plus simple possible. Et le problème à gauche, c’est qu’il n’y avait aucun récit alternatif prêt à être suggéré à l’opinion, à part celui proposant de poursuivre un keynésianisme vieillissant, avec la crise économique du capitalisme au milieu des années 1970.
Ce dont les populations ont besoin en temps de crise, c’est un récit nouveau et, surtout, qui semble vraiment nouveau.
Mais ce dont les populations ont besoin en temps de crise, c’est un récit nouveau et, surtout, qui semble vraiment nouveau. Les néolibéraux ont compris cela ; la gauche, non ! Ce qui m’inquiète aujourd’hui, c’est que, depuis 2008, quand le récit néolibéral a commencé à s’effondrer lors de la crise des subprimes, nous n’avons pas vraiment su développer un nouveau narratif. Et le récit actuel qui semble en bonne voie de devenir hégémonique est celui du fascisme, telle une idéologie « zombie ». Nous sommes peut-être en train de passer de l’hégémonie culturelle du néolibéralisme à celle de l’idéologie fasciste, les deux, in fine, ayant plus ou moins le même but : empêcher les revendications des populations.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Didier Lestrade : « On assiste à des retours en arrière effroyables »

Faire face à la guerre commerciale de Trump

Le monde d’avant Trump n’est plus une option