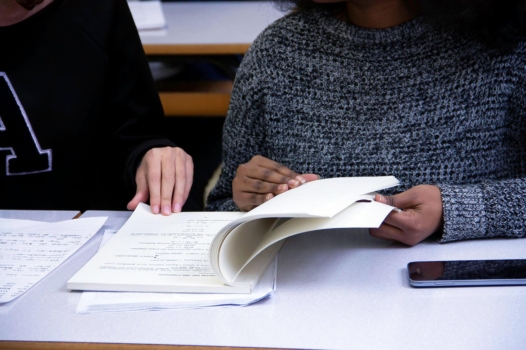« La recherche est essentielle pour comprendre ce qui nous arrive »
Weldehiwot Birhanu, anthropologue à l’université de Mekele (Éthiopie), évoque ses craintes suite aux affrontements qui ont éclaté entre deux factions du Front de libération du peuple du Tigré.
dans l’hebdo N° 1857 Acheter ce numéro

© Michele Spatari / AFP
Le 11 mars, en Éthiopie, des affrontements ont éclaté entre deux factions du Front de libération du peuple du Tigré, au pouvoir depuis plus de vingt ans, faisant craindre un retour de la guerre dans la région du Tigré. Weldehiwot Birhanu, anthropologue à l’université de Mekele, évoque ses craintes et la nécessité de poursuivre la recherche malgré tout.
Je suis enseignant-chercheur en sciences sociales et je travaille sur les conséquences de la guerre de 2020-2022 sur ma région, le Tigré, dans le nord de l’Éthiopie. Coûte que coûte. Tous les jours à Mekele, ma ville natale, je me rends en rickshaw dans un quartier un peu à l’écart pour y conduire mes recherches. Il y a beaucoup d’anciens soldats qui vivent ici, tous âgés d’une vingtaine d’années et qui ont combattu pour l’armée du Tigré il y a deux ans.
Je les interviewe. Sur place, j’ai un petit bureau, même s’il n’y a pas d’eau et que l’électricité et internet ne fonctionnent pas toujours. J’y donne des cours. En fait, ce quartier est le campus de mon université. Ces anciens soldats, sujets de mes recherches, sont aussi mes étudiants. Ils ont posé les armes et repris le chemin de l’école. Une école qui rappelle la guerre. Comme toutes les écoles ici. Au centre-ville, le grand lycée Yohannes-IV a servi de baraquement aux soldats de l’armée fédérale. Mais les jeunes y étudient de nouveau. Coûte que coûte.
Pendant la guerre, des années de travaux qui n’avaient pas pu être numérisés se sont évaporées.
Pendant la guerre, des années de travaux qui n’avaient pas pu être numérisés se sont évaporées. Il a fallu se serrer la ceinture car, pendant deux ans, nous n’avons pas été payés. La famine et l’inflation ont mangé nos économies alors que nous attendions la fin des bombardements et des occupations successives. Aujourd’hui, nous avons repris le travail et nous essayons de donner du sens à notre environnement qui a tant changé. Mes recherches se concentrent surtout sur le retour à la vie civile de ces jeunes soldats qui ont parfois perdu leurs parents et n’ont plus que l’armée.
Mais il n’y a pas qu’eux. Je m’intéresse également aux nombreuses personnes déplacées de force, arrachées à leur contexte rural et obligées de s’adapter aux codes impitoyables de la ville. Il y a aussi les réfugiés érythréens, qui se sont retrouvés pris entre deux feux et qui n’avaient, comme beaucoup d’autres, aucun moyen de subsistance. Tous ces gens développent des tactiques et des croyances pour s’en sortir et être résilients.
Certaines méthodes sont mauvaises, au sens où elles empirent leur situation, mais d’autres sont bonnes. En fait, j’essaie de savoir comment font les survivants pour survivre, quelles sont leurs stratégies, celles qui viennent d’en bas, et comment on peut s’en inspirer pour mettre en place des solutions à long terme afin d’aider notre processus de « désarmement, démobilisation et réintégration » – DDR dans notre jargon. Humainement, c’est parfois dur. Mais on continue. Coûte que coûte.
« Tout le monde parle du retour de la guerre »
Le 11 mars, le gouvernement régional de transition instauré par le gouvernement fédéral éthiopien a été chassé par une faction régionale adverse. Les quelques partenaires de recherche occidentaux que nous avions réussi à faire revenir depuis 2022 ont dû plier bagage et partir du jour au lendemain sur ordre de leur ambassade. Tout le monde parle du retour de la guerre. Devant les banques se forment de longues files de personnes venues retirer leurs économies.
Ici, les gens ont connu la folle inflation de 2020-2022, quand la région était coupée de tout. Ils veulent faire des stocks. Mais le marché les a devancés et le prix du riz a augmenté de presque 20 %. Quant à l’essence, elle est désormais quasiment introuvable en dehors du marché noir. Les prix des transports grimpent, et peut-être que bientôt je devrai me passer de rickshaw pour aller à l’université.
La recherche est essentielle pour comprendre ce qui nous arrive, guérir les traumatismes, créer de la mémoire.
Dans quelques mois ou quelques semaines, peut-être que mes étudiants repartiront au front, et peut-être que mon bureau servira de prison ou d’hôpital de fortune. Peut-être aussi que mes recherches seront de nouveau détruites, que je serai de nouveau sans salaire et que je devrai de nouveau me cacher avec ma famille pour éviter les bombes. Des amis me disent que l’espoir est mort à Mekele, qu’il faut que je prenne la route de l’Europe pour ne jamais revenir.
Mais je continuerai mon travail. Ici, la recherche est essentielle pour comprendre ce qui nous arrive, guérir les traumatismes, créer de la mémoire et de la réconciliation. Avec la recherche, nous pouvons regarder notre passé en face et nous préparer pour le futur. Alors, même si la guerre revient, et que l’on repart pour une période d’ombre et de silence, mes collègues et moi nous continuerons. Coûte que coûte.
La carte blanche est un espace de libre expression donné par Politis à des personnes peu connues du grand public mais qui œuvrent au quotidien à une transformation positive de la société. Ces textes ne reflètent pas nécessairement la position de la rédaction.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

« Je voulais continuer à travailler »

« Parfois, quand on tire sur la chambre des enfants, ils meurent »

« Ils nous disent qu’on n’est pas en prison, mais c’est pire qu’en prison »