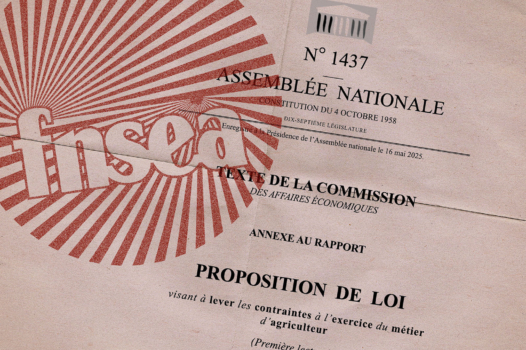Justice climatique : quatorze citoyens en colère
Plusieurs citoyen·nes et des associations attaquent l’État français en justice pour dénoncer la faiblesse de sa politique d’adaptation au changement climatique. Une action pour lutter contre les inégalités sociales et le sentiment de solitude des sinistré·es climatiques.
dans l’hebdo N° 1857 Acheter ce numéro

© Affaire du siècle
« Lors de la canicule en 2018, des fissures sont apparues du jour au lendemain dans notre maison, construite en 2005. Notre vie a basculé. Tous les jours, on entend des bruits, des craquements… C’est angoissant ! Je ne veux même plus que nos enfants viennent dormir à la maison », raconte Mohamed Benyahia, qui vit dans la Sarthe et qui est touché par le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Celui-ci est amplifié par la succession de périodes de sécheresse et de fortes pluies, qui rendent instable la structure des bâtiments. Près de dix millions d’habitations en France seraient exposées à ce risque, car construites sur des sols argileux.
C’est un sinistre qui ne s’arrête jamais.
M. Benyahia
« C’est un sinistre qui ne s’arrête jamais. Chaque jour passé est un jour de plus exposé à ces risques, et pourtant on a le sentiment que personne n’agit pour réparer cela. On espère que, cette fois, l’État prendra conscience de la gravité de la situation », clame avec émotion celui qui est devenu président de l’association Urgence maisons fissurées-Sarthe. Face à l’inertie des pouvoirs publics, il a décidé de franchir un cap dans son mode d’action : attaquer l’État français en justice face au manque d’adaptation au changement climatique.
Une action inédite dans l’Union européenne, portée par quatorze citoyen·nes et associations corequérant·es (1), dont Oxfam, Greenpeace et Notre affaire à tous, qui avaient porté le recours de « l’Affaire du siècle » pour inaction face au changement climatique en 2018. Canicules, inondations, problèmes d’accès à l’eau, pertes agricoles, retrait-gonflement des argiles… Toutes et tous subissent ces aléas depuis plusieurs années et accusent l’État français de ne pas remplir son obligation de protéger ses citoyens face à ces transformations.
Jean-Jacques Bartholome, Salma Chaoui, Marie Le Mélédo, Jean-Raoul Plaussu-Monteil, Jérôme Sergent, Association nationale des gens du voyage citoyens (représentée par William Acker), Association Urgence maisons fissurées (représentée par Mohamed Benyahia), Ghett’up (représentée par Rania Daki), Locataires ensemble (représentée par Salim Poussin), Miramap (représenté par Évelyne Boulongne et Florent Sebban), Mayotte a soif (représentée par Racha Mousdikoudine), Notre affaire à tous, Greenpeace France, Oxfam France.
« Aujourd’hui, 62 % des Français sont concernés par les risques accrus liés au changement climatique et nous ne sommes pas prêts ! Il est important de mettre en avant les personnes touchées en premier lieu car c’est leur quotidien, et pas une lubie d’associations pessimistes ! », indique Jérémie Suissa, délégué général de Notre affaire à tous.
Un plan climat trop superficiel
La cible première de cette procédure judiciaire : le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (Pnacc3), publié en mars. Il est jugé bien trop frileux et superficiel pour faire face à un scénario de réchauffement mondial moyen de l’ordre de +3 °C, c’est-à-dire +4 °C en France métropolitaine. Même le Haut Conseil pour le climat – créé en 2018 par Emmanuel Macron – a émis un avis dans ce sens, affirmant que « la France n’est pas encore prête à faire face aux impacts du changement climatique » et déplorant notamment des financements adaptés « insuffisants ».
Dans leur demande préalable de 162 pages, les corequérants estiment que, sur les 310 actions du Pnacc3, « seules 48 font l’objet d’un chiffrage ou d’une évaluation budgétaire ». De surcroît, les sources de financements telles que le fonds Barnier, le fonds vert et les agences de l’eau ont vu leur chiffrage initial diminuer.
Vivre à +4° C en 2100
Le plan national d’adaptation au changement climatique, attendu depuis deux ans, a enfin été dévoilé avec comme horizon alarmant une France à +4 °C en 2100. Résultat : des mirages budgétaires et une litanie de mesures qui invisibilise les populations les plus vulnérables. Notre dossier (mars 2025).
Le recours s’appuie sur l’obligation générale d’adaptation au changement climatique à la charge de l’État, fixée par la Charte de l’environnement, qui consacre le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Mais aussi sur le droit européen, avec l’article 5 de la loi européenne sur le climat, adoptée en 2021. Ce texte impose aux États membres de l’UE une obligation de « progrès constants » et une obligation d’adopter et de mettre en œuvre des stratégies et des plans d’adaptation nationaux.
Dans un premier temps, un courrier argumenté a été adressé le 8 avril au président de la République et à plusieurs ministres pour demander la révision du PNACC3 et l’adoption de nouvelles mesures à la hauteur. Si l’État ne répond pas favorablement dans les deux mois, le Conseil d’État sera saisi. Même s’ils sont confiants, les avocats ne s’interdisent pas d’aller jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme en cas de mauvaise surprise.
Ils pourront s’appuyer sur la jurisprudence des Aînées pour le climat suisse, qui ont réussi à faire condamner leur pays pour inaction climatique devant cette cour de justice internationale spécialisée dans les droits humains. Un horizon d’espoir pour les sinistré·es climatiques, qui ont tous témoigné de leur désarroi et de leur sentiment de solitude.
Expositions et vulnérabilités inégales
Parmi ces sinistré·es climatiques, beaucoup témoignent des difficultés à vivre un quotidien serein, notamment à cause d’un logement inadapté aux canicules. C’est le cas de Jean-Jacques Bartholome. L’homme de 68 ans, en situation de handicap moteur, vit depuis quarante-deux ans dans le quartier Villeneuve, à Grenoble. Il a vu les vagues de chaleur s’intensifier et les températures de son appartement augmenter au fil des années sans que son bailleur ne réalise d’aménagement spécifique.
Un jour d’été 2023, son thermomètre indique 32 °C dans son appartement au petit matin. Le pic de trop. « J’avais des volets en plastique qui se fermaient manuellement, mais je n’y arrivais pas en raison de mon handicap. J’ai appelé un voisin pour qu’il le fasse, mais c’était pour toute la journée, je n’allais pas le déranger sans cesse. J’habite au 8e étage, j’ai le soleil à partir de 6 h 30… » Avec l’association Alliances citoyennes et le syndicat des Handi-citoyen·nes, qu’il a créé, ils décident de réagir : « On a fait une action chez le bailleur social. En plus c’était tout climatisé dans leurs locaux, on était bien ! » s’amuse-t-il.
Le changement climatique et ses conséquences sont profondément inégalitaires, car les plus responsables n’en paient pas le prix le plus fort.
C. Duflot
La pression médiatique aidant, Jean-Jacques Bartholome obtient des aménagements, notamment des volets électriques. Mais il veut désormais agir au niveau collectif et interpeller l’État. « Il y a des millions de personnes en situation de handicap, visible ou invisible, qui ont des difficultés au quotidien à cause des vagues de chaleur, avec des impacts sur leur logement ou leur état de santé. Quand il fait vraiment trop chaud, mon traitement médical habituel fait moins effet, et je ne suis pas le seul. »
En 2022, un rapport de la Fondation Abbé-Pierre (renommée Fondation pour le logement des défavorisés) indiquait l’existence de 5,2 millions de passoires thermiques impossibles à chauffer en hiver, qui se transforment en bouilloires énergétiques impossibles à refroidir en été. L’un des écueils majeurs du PNACC3, que cette coalition veut souligner, est le manque de prise en compte des inégalités d’exposition et de vulnérabilité aux risques climatiques, selon les catégories sociales et les territoires.
« Nous savons aujourd’hui que le changement climatique et ses conséquences sont profondément inégalitaires, car les plus responsables (les plus riches, les générations anciennes…) n’en paient pas le prix le plus fort, mais leur mode de vie aggrave le changement climatique, explique Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France. Avec ce recours, nous nous mettons au service des personnes les plus vulnérables pour leur dire qu’ils ne sont pas seuls, et pour sommer l’État d’agir ! »
En effet, les ménages pauvres et modestes, les femmes, les enfants, les groupes marginalisés, les territoires ultra-marins sont à la fois plus exposés au risque climatique et plus vulnérables, puisqu’ils manquent souvent de ressources pour s’adapter.
« Vivre sans eau à Mayotte, ce sont des nuits cauchemardesques en attendant le matin, quand il faudra dire à ses enfants qu’il n’y a pas de petit-déjeuner, qu’ils devront porter des vêtements sales. C’est ne pas pouvoir se laver, aller aux toilettes, parfois ne pas aller à l’école… Mais devoir quand même payer des factures de 300 euros alors qu’on n’a pas accès à l’eau potable », résume Racha Mousdikoudine, présidente de l’association Mayotte a soif, corequérante de l’action. Des difficultés qui s’aggravent lors d’événements climatiques extrêmes, comme les sécheresses ou les cyclones, de plus en plus fréquents.
L’Association nationale des gens du voyage citoyens, représentée par William Acker, et Ghett’up, qui agit en faveur de la justice sociale et climatique des jeunes de quartiers populaires, représentée par Rania Daki, se sont également associés à l’action en justice, avec l’espoir de mettre l’État face à ses responsabilités, pour des populations qui se sentent délaissées sur tous les plans de leur vie. Une nouvelle « Affaire du siècle » dédiée à l’adaptation climatique qui pourrait aider des millions de citoyen·nes français·es et constituer une avancée majeure pour la justice climatique.
Pour aller plus loin…

Limousin : la ferme-usine de la discorde

Une pharaonique autoroute fluviale dans les Hauts-de-France

À Mer, une muraille de plateformes logistiques