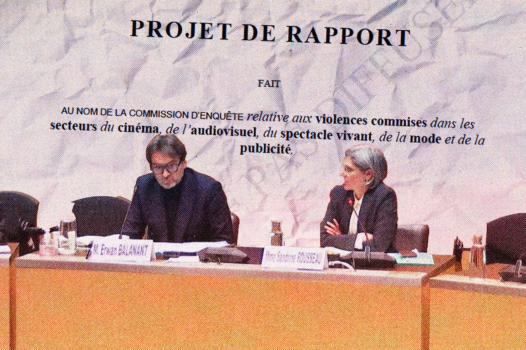Julie Couturier : « Attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie »
Depuis la condamnation de Marine Le Pen, le Rassemblement national et sa cheffe de file crient à une décision « politique », opposant l’institution judiciaire à une supposée « souveraineté populaire ». Repris jusqu’au sein du gouvernement, ces discours inquiètent la présidente du Conseil national des barreaux.
dans l’hebdo N° 1857 Acheter ce numéro

© Maxime Sirvins
Julie Couturier est avocate depuis 1995, date à laquelle elle a prêté serment. En décembre 2023, elle est élue présidente du Conseil national des barreaux, l’institution en charge de représenter les 164 barreaux du territoire et les près de 78 000 avocats du pays. Son mandat s’étend jusqu’en 2026.
Dimanche 6 avril, Marine Le Pen s’est défendue d’attaquer l’État de droit tout en organisant un rassemblement pour dénoncer ce qu’elle désigne comme une injustice. Comment analysez-vous ce paradoxe ?
Julie Couturier : Je représente la profession d’avocats et, aujourd’hui, celle-ci est très préoccupée par un certain nombre d’attaques concernant l’État de droit. Ce qui est à l’œuvre, c’est une fragilisation de l’institution judiciaire, avec une attaque ciblée contre elle. On peut critiquer une décision de justice. Sur le plan judiciaire déjà, avec l’exercice des voies de recours – et dans le cas de Marine Le Pen, celles-ci sont activées. Mais aussi sur le plan médiatique : je ne suis pas gênée qu’on vienne contester dans la presse l’application que les juges ont faite de la loi.
En revanche, plusieurs choses sont inacceptables. En premier lieu, les attaques sur les juges en tant que personnes. C’est inadmissible que le visage et le nom de la magistrate qui a présidé la formation du tribunal soient jetés en pâture sur les réseaux sociaux. D’autant plus que la décision a été rendue en collégialité : trois magistrats ont jugé et ont appliqué la loi. On peut contester l’interprétation qui en a été faite, mais c’est la loi. Et la loi est incontestablement la même pour tous.
Pourtant, de nombreux élus et personnalités politiques de tous bords ont remis en cause cette condamnation, arguant que ce devait être au « peuple » de décider de l’inéligibilité d’un politique, et non à la justice. Les élus sont-ils au-dessus des lois ?
Je ne sais pas s’ils ont ce sentiment mais, s’ils l’ont, ils ont tort de l’avoir ! Il est heureux que nous ayons des institutions suffisamment solides pour que les élus ne soient pas au-dessus des lois. Le reproche fait ces derniers jours à l’institution judiciaire est d’avoir pris une décision politique. C’est ce qu’a clairement dit Marine Le Pen à plusieurs reprises. Je ne peux que m’inscrire en faux. Ce n’est absolument pas une décision politique, bien que celle-ci ait des conséquences politiques. Ce n’est pas la même chose !
Je ne peux qu’être gênée de voir des membres du gouvernement et des parlementaires critiquer une décision de justice.
Pourquoi cette décision n’est-elle pas politique, selon vous ?
Aujourd’hui, on parle abondamment de l’inéligibilité et de l’exécution provisoire. Mais presque jamais du fond du dossier. Or il y a quand même des faits. Bien sûr, Marine Le Pen et tous ceux qui ont été condamnés ont formé appel et restent donc présumés innocents – j’insiste là-dessus – jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Malgré tout, depuis quelques années, tout le monde appelle à une moralisation de la vie politique. Plusieurs textes de loi ont été adoptés dans ce sens, pour lutter contre certaines pratiques et certaines dérives des politiques. Donc il me semble tout à fait normal que ces textes soient aujourd’hui appliqués. Et appliqués pour tout le monde, y compris des personnalités politiques de premier plan.
Dans les critiques de la condamnation formulées par la leader du Rassemblement national, on voit réapparaître le mythe du juge rouge, cette idée selon laquelle elle aurait été condamnée pour des raisons non pas judiciaires, mais politiques. Comment combattre ce mythe ?
J’ai coutume de dire que les magistrats, comme les avocats, ont deux bornes : la loi et la déontologie. On ne peut pas reprocher à un avocat d’avoir une stratégie de défense pugnace dans un dossier tant qu’il respecte la loi et sa déontologie. Pour les magistrats, c’est la même chose. Si le juge applique la loi et qu’il le fait dans le respect de ses obligations déontologiques, il n’y a effectivement rien à dire. Et dans le cas de Marine Le Pen, c’est tout à fait ce qu’il s’est passé.
Ce qu’on entend en creux dans votre discours, c’est la question de la séparation des pouvoirs. Quand un premier ministre en exercice se permet de commenter une décision de justice, comme plusieurs autres ministres, n’y a-t-il pas une crainte de voir le pilier de la séparation des pouvoirs s’éroder ?
Bien sûr, on a une forte inquiétude sur ce sujet. L’État de droit, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que ça représente concrètement. Qu’est-ce que l’État de droit ? Un socle de règles sur lesquelles se fondent notre société et trois grands principes qui régissent le tout : l’égalité des citoyens devant la loi ; la hiérarchie des normes qui fait qu’un traité européen est supérieur au texte intérieur, que la Constitution est supérieure à la loi, qui est supérieure au décret ; et enfin la séparation des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Ce dernier principe est très important. Donc je ne peux qu’être gênée de voir des membres du gouvernement et des parlementaires critiquer une décision de justice. Cela fragilise l’institution judiciaire et donc ce principe fondamental de notre État de droit.
Notre système tient sur cet équilibre entre les trois pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire.
Au vu de toutes ces réactions, les magistrats de la cour d’appel ne ressentiront-ils pas une forte pression qui pourrait les empêcher de prendre une décision sereine ?
Les magistrats qui rendront cette décision sont des professionnels de justice aguerris. J’ai confiance en leur indépendance, à laquelle ils sont très attachés comme nous, les avocats, y sommes attachés. Je ne doute pas qu’il y ait des avocats et des magistrats courageux qui pourront s’abstraire de cette pression pour essayer de statuer de façon sereine.
Cette séquence médiatico-politique risque-t-elle de marquer durablement l’institution judiciaire ?
L’institution est souvent attaquée, c’est n’est pas la première fois. Aujourd’hui, il est difficile de répondre à cette question, car on n’a pas suffisamment de recul. On est, hélas, dans une société de l’immédiateté. Les effets à long terme sur l’institution judiciaire sont difficilement prévisibles. En revanche, ce qui est clair, c’est que l’institution judiciaire est sous-dotée par rapport à nos voisins européens, même si elle a connu quelques augmentations budgétaires récemment. L’état de délabrement de la justice est une réalité. En plus de cela, ces dernières années, le droit s’est considérablement densifié.
Le nombre d’articles de loi a augmenté de 65 % et le nombre d’articles de règlement de 46 % en vingt ans. Le travail de tous les acteurs de la justice, que ce soient les magistrats, les avocats ou les greffiers, est devenu plus complexe, et cela explique aussi les longs délais de la justice, qui écornent la confiance que les justiciables ont dans l’institution. Aujourd’hui, 70 % des dossiers judiciaires en France relèvent du civil. Les problèmes de surendettement, de logement, de famille, la justice économique, la justice prud’homale : c’est cela, la majorité des procès qui occupent les Français.
Pourtant, ce sont bien les politiques qui ont façonné cette inflation législative et rogné les budgets de la justice, non ?
Tout à fait. Il est d’ailleurs paradoxal de voir des politiques – ceux qui font la loi – se permettre de contester des décisions qui ne font qu’appliquer les lois qu’ils ont eux-mêmes écrites. Il y a un vrai sujet légistique, avec une tendance des politiques à légiférer sous le coup de l’émotion sans évaluer la norme, que ce soit en amont ou en aval, et d’empiler des dispositifs sans forcément qu’il existe de cohérence entre eux.
L’État de droit – ce socle de principes – est intangible et sacré.
La séquence actuelle est également marquée par une rhétorique autour de « la justice contre le peuple », avec une opposition entre ces deux notions, comme si elles étaient antithétiques. N’est-ce pas là un contresens total au regard de l’institution judiciaire ?
Si, complètement ! Cela fait quelques mois qu’on entend cette petite musique. Ce n’est pas seulement la justice qui est attaquée, mais bien l’État de droit, dans son ensemble, qui est décrit comme une contrainte et un frein à l’action publique. Entendre que nous serions gouvernés par un « gouvernement des juges » – un fantasme – et que l’État de droit serait « contraire » à la souveraineté du peuple est étonnant, a minima. En réalité, c’est l’inverse. Notre système tient sur cet équilibre entre les trois pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire.
Dire que le peuple devrait décider de tout est donc, pour vous, contraire à l’État de droit et à la démocratie ?
Oui, on confond deux choses : l’état du droit et l’État de droit. L’état du droit évolue tous les jours. Le Parlement le modifie en votant des textes pour s’adapter aux changements de la société. C’est tout à fait normal. Ce n’est pas un danger et l’état du droit n’est pas sacré. L’État de droit – ce socle de principes que je décrivais précédemment –, en revanche, est intangible et sacré.
Lorsque Marine Le Pen et ses soutiens lancent des « appels au peuple » après une décision de justice, cela peut rappeler certaines heures les plus sombres de notre histoire. Craignez-vous les prochaines semaines ?
J’espère que la séquence va se calmer. Déjà parce que les voies de recours vont être exercées. Et aussi parce qu’une actualité chasse l’autre. Mais il reste une inquiétude largement partagée dans notre institution concernant des menaces physiques de plus en plus récurrentes contre des magistrats ou des avocats. Il ne faut pas oublier qu’il y a quelques mois un média d’extrême droite a publié une liste d’avocats et de magistrats considérés comme « responsables du chaos migratoire ».
Pendant la campagne des élections législatives, il y a eu une liste d’avocats « à éliminer », parce qu’ils s’étaient permis d’écrire une tribune pour appeler à faire barrage à l’extrême droite. Ces phénomènes d’intimidation sont de plus en plus fréquents. Il y a une responsabilité du politique dans cette libération de la parole tendant à remettre en cause l’État de droit. Or, attaquer l’institution judiciaire, c’est attaquer l’État de droit et attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie.
Avez-vous l’impression que la justice est soutenue à la hauteur des attaques dont elle est aujourd’hui l’objet ?
C’est difficile à dire. Les derniers sondages montrent qu’une majorité de Français comprennent la décision de justice concernant la condamnation de Marine Le Pen. C’est quand même positif. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, nous a aussi défendus. Mais il est certain que tous les soutiens sont aujourd’hui bienvenus. Cependant, plusieurs personnels de l’institution, juges comme avocats, sont régulièrement menacés, même si on en parle moins, parce qu’il ne s’agit pas de dossiers politiques mais d’affaires de criminalité organisée. Là, la force des attaques de Marine Le Pen donne un coup de projecteur.
La tendance est à l’affaiblissement de l’autorité judiciaire et des droits de la défense.
Récemment, vous vous êtes opposée à la proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic, qui, pour vous, remet en cause les droits de la défense et le droit à un débat contradictoire. Est-ce aussi, selon vous, une attaque sur l’État de droit ?
Les avocats ne sont pas des irresponsables, comme on a pu l’entendre. Nous aspirons, comme tout un chacun, à la sécurité. Mais lutter contre le narcotrafic ne doit pas mettre de côté les droits de la défense et les garanties fondamentales. La proposition de loi, telle qu’elle a été présentée, est déséquilibrée, notamment avec des atteintes au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Or, quand on parle de l’État de droit, ces principes sont essentiels.
Cela témoigne-t-il d’un effritement progressif de l’État de droit ?
Les institutions sont solides, même si elles sont attaquées. La tendance est toutefois à l’affaiblissement de l’autorité judiciaire et des droits de la défense. Il y a un pouvoir des mots tout à fait délétère. Quand Marine Le Pen se compare à Martin Luther King ou que Bruno Retailleau déclare que l’État de droit n’est ni sacré ni intangible, on observe un glissement sémantique inquiétant.
Les médias sont-ils aussi responsables de ce glissement en reprenant des expressions toutes faites sans forcément les définir ? Ou en invitant Marine Le Pen immédiatement après sa condamnation ?
Que Marine Le Pen soit invitée au 20 heures ne m’a pas particulièrement choquée. Quoi qu’on en pense, elle reste une personnalité politique de premier plan. Malgré tout, sur ce sujet comme sur les autres, je pense qu’il faut bien veiller à ce que le contradictoire soit respecté. Or ce n’est pas toujours le cas. Certains médias ont incontestablement une responsabilité, tout comme les réseaux sociaux. On est dans une société de la réaction immédiate, qui laisse parfois sur le côté le temps long, la complexité, et la nuance. Ce que nous, précisément, on essaie d’apporter. Notre défi est d’essayer de faire de la pédagogie pour expliquer que les garanties procédurales et l’État de droit protègent tout le monde.
Pour aller plus loin…

Face au fichage de « Frontières », les collaborateurs parlementaires exigent des mesures concrètes

À la Bourse du Travail à Paris, une journée pour dessiner une « sécurité sociale du logement »

La justice française refuse de livrer le militant antifasciste Gino à la Hongrie