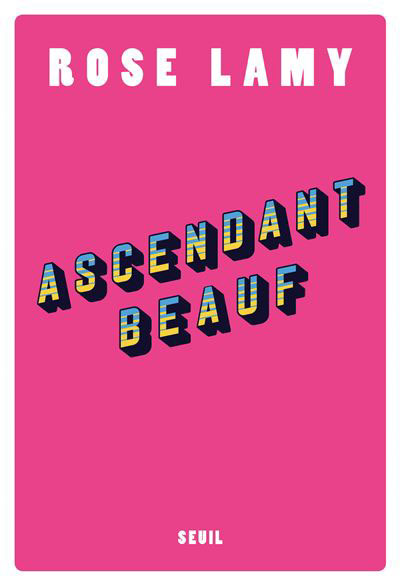Rose Lamy : « La gauche doit renouer avec ceux qu’elle considère comme des ‘beaufs’ »
Après s’être attaquée aux discours sexistes dans les médias et à la figure du bon père de famille, l’autrice met en lumière les biais classistes à gauche. Avec Ascendant beauf, elle plaide pour réinstaurer le dialogue entre son camp politique et les classes populaires.

© Marie Rouge
Ascendant beauf / Rose Lamy, Seuil, 176 pages, 18,50 euros.
Rose Lamy est née en 1984, et a grandi entre la Haute-Savoie et Bourges. Après avoir travaillé dans le secteur de la musique, dans des centres d’appels puis à la SNCF, elle lance son compte Instagram féministe @ preparez_vous_pour_la_bagarre, en 2019. Elle y est aujourd’hui suivie par 252 000 personnes. Avant Ascendant beauf, elle a publié deux essais : Défaire le discours sexiste dans les médias
et En bons pères de famille (2021 et 2023, JC Lattès).
Dans votre livre, vous tentez de définir le « beauf » à travers le regard d’une gauche bourgeoise. Pour elle, le beauf n’est-il pas simplement un pauvre qui a « mauvais » goût ?
Rose Lamy : C’est ce que je pense, oui. La gauche a inventé un « mauvais pauvre ». Avant Mai-68, il y avait le pauvre idéalisé, le prolétaire magnifique qui allait œuvrer pour l’émancipation générale. Le référendum de 1969, qui va installer la droite au pouvoir après Mai-68, donne naissance à un « pauvre méprisable ». Cabu s’en saisira lorsqu’il dessine le beauf comme quelqu’un de populaire, raciste, sexiste et alcoolique.
On a intériorisé beaucoup de codes néolibéraux à gauche.
La théorie du sociologue Gérard Mauger, que je reprends dans mon livre, c’est que cette détestation du « beauf » viendrait de la déception du mouvement gauchiste, comme il l’appelle, à l’égard d’une partie des classes populaires qui ont soutenu De Gaulle. Finalement, c’est ce pauvre qui s’est émancipé des attentes de la gauche, qui le méprise en retour. Il est méprisé parce qu’il existe en dehors de l’autorité bourgeoise. On voit cette distance avec la question du prénom, posé comme un emblème séparant le bon goût du « goût beauf ».
Certains prénoms sont-ils rejetés uniquement parce qu’ils ne sont pas perçus comme des prénoms « bourgeois » ?
Je me suis demandé ce qu’était un prénom beauf, et je suis tombée sur le travail du professeur de sociologie Baptiste Coulmont. Il explique que les prénoms considérés comme beaufs sont des prénoms américains ou bretons : Kevin, Kimberley, Dylan, Kylian, etc. Avant, il existait un cycle descendant des prénoms : les bourgeois donnaient des prénoms à leurs enfants, et quelques générations plus tard, ces prénoms arrivaient parmi les classes populaires. À ce moment-là, ils devenaient ringards. Dans la sanction du prénom beauf, il y a une colère portée à l’égard de la liberté des personnes qui choisissent des prénoms en dehors des codes bourgeois.
À l’inverse, vous parlez aussi de ces bourgeois qui s’approprient des modes de vie populaires. Est-ce une sorte de « gentrification culturelle » ?
Le mépris de classe est facile à mettre en lumière. J’ai eu plus de difficultés à mettre en mots quelque chose qui avait tendance à m’irriter depuis plusieurs années, alors je suis partie d’un exemple : la reprise de la chanson de Larusso « Tu m’oublieras », par Juliette Armanet. Je n’ai aucun problème avec les reprises, elles font partie de l’histoire de la musique. Là, on est sur une nouvelle version qui transforme l’originale. Elle est allégée de ses attributs beaufs et reprend des codes de la chanson française : elle est plus lente, jouée au piano…
Pointer du doigt le beauf raciste, c’est une bonne excuse pour ne pas faire d’introspection.
Les commentaires sur les réseaux sociaux disaient : « Mais en fait, elle est belle cette musique. » Ce « en fait » me gêne. Moi, j’aime cette version « aussi ». Il sous-entend ceci : est considéré comme beau ce qui reçoit l’approbation d’une partie de la population, censée détenir le bon goût. Sinon, c’est moche, voire beauf. Paradoxalement, c’est parce qu’une œuvre plaît au plus grand nombre qu’elle est méprisable.
Le snobisme de gauche dissimule-t-il un élitisme de droite ?
Je pense, oui. On a intériorisé beaucoup de codes néolibéraux à gauche. On a aussi intériorisé la méritocratie. On nous a vendu l’histoire de l’école qui mettrait tous les individus sur un pied d’égalité au départ, comme si, par la suite, les trajectoires de vie reposaient sur les responsabilités individuelles. D’abord, l’école, comme tous les autres services publics, est en train d’être détruits. Cet idéal vole en éclats. Surtout, en individualisant les trajectoires, il devient légitime de pointer du doigt celles et ceux qui n’ont pas réussi. Et de les mépriser. Les beaufs seraient donc ceux qui restent où ils sont, ceux qui ne sont jamais partis, résignés et immobiles.
À gauche, l’idée selon laquelle « quand on veut, on lit, et quand on lit, on se transforme » est largement partagée. Comme si, lorsqu’on ne partage pas les codes culturels bourgeois, on n’est pas pleinement conscient, pleinement légitime à donner son avis. C’est une vision réactionnaire typique du XIXe siècle qui consiste à avoir des doutes sur l’intérêt d’une démocratie de masse parce que le pauvre ne saurait pas exactement ce dont il a besoin. Cet élitisme, c’est une posture parfois inconsciente. Et à gauche, on le pratique toutes et tous, moi comprise. Le mépris, j’en ai pratiqué, j’en ai reçu aussi.
Le regard porté sur l’électorat du Rassemblement national reproduit-il des logiques de domination classiste ?
C’est pratique d’avoir des boucs émissaires. Ma démarche intellectuelle consiste souvent à les débusquer pour mieux révéler ce que cela dit de notre société. Je l’avais déjà fait dans En bons pères de famille (JC Lattès, 2023). On nous a inventé un mythe du monstre, la bave aux lèvres, qui agresse dans l’espace public des femmes. Quand on défait ce mythe-là, on constate que les hommes violents sont plutôt des pères de famille ou des proches des victimes de violences sexuelles.
Pointer du doigt le beauf raciste, c’est une bonne excuse pour ne pas faire d’introspection. Pendant ce temps, on ne s’interroge pas sur son propre racisme. C’est pratique, c’est confortable. Le mépris que l’on adresse à notre fameux « tonton raciste » dans les repas de famille n’est peut-être pas la bonne posture pour qu’il change. Je n’en peux plus de ces articles pour « coacher son tonton raciste ». Pour qui on se prend ?
Si la figure du beauf est couramment utilisée à gauche, n’est-elle pas aussi l’objet d’instrumentalisation de la part de l’extrême droite ?
Oui, c’est le cas dans tous les camps. Il y a du mépris extrêmement assumé à droite et chez les néolibéraux : les gens qui ne sont rien, les gens qui ont loupé leur vie s’ils n’ont pas de Rolex, les cancers de la société, les assistés, la France d’en bas, les sans-dents… Ils assument de prendre les classes populaires pour des moyens de production et d’insulter tout ce qui n’est pas assez productif. Le RN, lui, est un parti bourgeois, une dynastie qui collabore avec le pouvoir économique. On le voit à l’étranger aussi : Trump qui s’allie avec les milliardaires, par exemple. Le discours de l’extrême droite pourrait sembler plus inclusif vis-à-vis des classes populaires. Pourtant, elle participe aux politiques actuelles de fermeture des services publics, aux discours budgétaires hostiles à la taxation des riches, etc.
Les blagues sur les beaufs que l’on entend partout tendent à déformer la réalité des classes populaires.
Au-delà de la question économique, l’extrême droite semble aussi se servir de la figure du beauf sur la question de l’identité.
Exactement. Quand j’ai commencé à écrire le livre, j’ai réalisé que c’était l’extrême droite qui interpellait les médias sur des séquences de mépris de classe. Je me suis dit que ça ne leur appartenait pas, que c’était impossible qu’elle soit la représentante de cette classe populaire. J’ai l’impression qu’on est tous un peu d’accord sur ce sujet de la récupération, mais qu’on ne sait pas quoi en faire. À gauche, on fait des posts Instagram pour dire que le RN n’est pas le parti des femmes ou le parti des pauvres, mais ça ne va pas plus loin. Ma petite pierre à l’édifice, c’est de montrer qu’il y a une dimension culturelle dans ce sujet de lutte des classes. La gauche doit renouer avec ceux qu’elle considère comme des « beaufs ».
Dans le livre, vous donnez plusieurs exemples de séquences médiatiques classistes, et vous dites qu’elles s’inscrivent dans un continuum des violences de classe. Pouvez-vous expliquer ce concept ?
Les féministes ont théorisé le continuum des violences sexistes. C’est l’idée qu’une blague, qui peut paraître légère, prépare le terrain à la banalisation de la violence et à la déshumanisation. Ce qui fait qu’à la fin on va avoir des comportements de violences sexistes, d’agressions sexuelles, et au bout des violences, des féminicides. Le bout du continuum, c’est la mort. En ce qui concerne les dominations de classe, les blagues sur les beaufs que l’on entend partout tendent à déformer la réalité des classes populaires. Une réalité que l’on connaît, à gauche, avec toutes les statistiques sur les écarts d’espérance de vie, sur la surreprésentation des classes populaires dans la mort au travail, dans les accidents de la route. Cet humour désensibilise et agit comme une violence de classe qui fait que l’on oublie ce que beaucoup vivent : la fermeture des services publics, des hôpitaux, des déserts médicaux, etc.
Dans le livre, vous parlez beaucoup de votre enfance, de la manière avec laquelle vous avez, à certains moments, voulu vous détacher de l’univers familial qui était le vôtre, puis à d’autres moments combien vous en étiez fière. Est-ce que l’univers professionnel dans lequel vous évoluez vous a souvent mis dans une situation de conflit de loyauté ?
Pas tant que ça, parce que j’ai vraiment eu beaucoup de boulots de ma classe sociale. J’ai aussi bossé dans la musique, dans cette industrie culturelle à laquelle je voulais appartenir. J’ai quand même réussi à avoir un CDI pendant quatre ans dans ce milieu, et je n’en suis pas peu fière ! Dans la musique, j’ai un peu dissimulé le fait que j’écoutais Jean-Jacques Goldman, je ne disais pas tout, je mentais un peu… Quand j’ai fait un stage dans une grande maison de disques, je n’ai pas donné trop de détails sur mon week-end au retour d’une fête en salle des fêtes.
Je ne pensais pas que mon livre serait à ce point sur le travail.
En dehors de ça, les boulots alimentaires que j’ai faits, c’est ce qui m’attendait par rapport à ma classe sociale. Je n’ai pas été sauvée par la méritocratie, j’ai eu un petit diplôme bac + 2… C’est établi par l’Observatoire des inégalités que j’allais me stabiliser professionnellement beaucoup plus tard. Il y a eu des « mauvais » choix de ma part, mais aussi une part de situation à laquelle je ne pouvais pas échapper. Je ne pensais pas que mon livre serait à ce point sur le travail. C’est vraiment à la fin que je me suis rendue compte que le sujet revenait dans toutes les parties. C’est sans doute une question à creuser, parce que le travail est aussi un accès à la politisation.
Vous vous considérez comme une transfuge de classe ?
Je ne pense pas. Un·e transfuge de classe suppose une transformation et, me concernant, je pense que c’est un peu trop tard. Je suis encore entre les deux : certes, j’ai un capital culturel et social indéniable. Mais c’est très récent, et cela reste fragile. On voit bien que c’est vain : j’ai essayé de me changer, mais on voit bien que cela n’a pas vraiment marché (rires). Dans l’expression, la manière de se tenir. Transclasse, peut-être.
Vos chapitres sont rythmés par des couplets de musiques populaires. À la fin du livre, vous évoquez aussi le cinéma et ses biais classistes. Pourquoi attachez-vous de l’importance à ces enjeux de représentation ?
Les législatives ont été un électrochoc sur la manière dont l’extrême droite pouvait accéder au pouvoir. Il y a eu cette urgence de décentrer une position politique de gauche qui était trop parisienne. Les questions des modes de vie et des codes culturels n’étaient pas encore très abordées. C’est cette question que j’ai voulu creuser.
La lutte contre le mépris culturel sans lutte des classes, c’est du tourisme.
Tout comme on dit qu’un féminisme sans lutte des classes serait du développement personnel, pour moi, la lutte contre le mépris culturel sans lutte des classes, c’est du tourisme. « Regardez, cette belle cathédrale à Bourges ! » D’accord, l’édifice est très beau, mais ce n’est pas tout. La ville est aussi au cœur de logiques de dominations, le tout dans une « faible densité démographique », comme on dit maintenant. C’est-à-dire dans la diagonale du vide, donc loin des services publics.
Je crois qu’on est nombreux et nombreuses à gauche à espérer la fin de cette polarisation, où l’on arrête de pointer du doigt les électeurs du RN. Je n’élude pas la question du racisme, bien entendu. Du suprémacisme, du pacte racial proposé par l’extrême droite.
Mais peut-être qu’une partie de ces électeurs peut encore changer d’avis. Peut-être aussi que les abstentionnistes, dont beaucoup sont méprisés parce qu’étant perçus comme des « beaufs », peuvent venir ou revenir à gauche. En tout cas, il faut arrêter de culpabiliser une partie de la population comme si la gauche n’avait rien à se reprocher. Même si on prend le risque de terminer les repas de famille avec des assiettes qui volent, il faut rétablir un langage commun.
Pour aller plus loin…

Didier Lestrade : « On assiste à des retours en arrière effroyables »

Julie Couturier : « Attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie »

« La science est la meilleure alliée des luttes pour la santé environnementale »