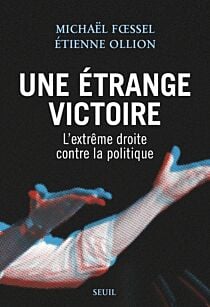Michaël Fœssel : « Nous sommes entrés dans un processus de fascisation »
Dans Une étrange victoire, écrit avec le sociologue Étienne Ollion, Michaël Fœssel décrit la progression des idées réactionnaires et nationalistes dans les esprits et le débat public, tout en soulignant la singularité de l’extrême droite actuelle, qui se pare des habits du progressisme.

© Maxime Sirvins
Michaël Fœssel enseigne la philosophie politique à l’École polytechnique. D’abord spécialiste de Kant, il a donné une dimension plus engagée à son œuvre. Dans Récidive. 1938 (PUF, 2019), tout en refusant le poncif de la « répétition des années 1930 », il avait mis en lumière comment la République française avait « prétendu se défendre en empruntant les armes de ses adversaires les plus acharnés ». Il analyse dans Une étrange victoire (Seuil) comment l’extrême droite actuelle adopte des postures a priori « progressistes » pour mieux en détourner l’analyse ou les objectifs. Quand le fascisme est capable de changer de visage par souci de coller à l’époque et, surtout, de ne pas perdre des voix.
Une étrange victoire. L’extrême droite contre la politique, Michaël Fœssel et Étienne Ollion, Seuil, 2024, 188 pages, 19 euros.
Peut-on parler de fascisme quand l’extrême droite d’aujourd’hui a tout d’« étrange », dites-vous, par rapport à sa propre histoire – comme lorsqu’elle défend Israël, la laïcité ou d’autres sujets qu’elle a toujours voués aux gémonies ? Et vous écrivez que cette « étrangeté » participe même de sa « victoire » culturelle ou idéologique.
Michaël Fœssel : Comme l’extrême droite d’aujourd’hui ne ressemble pas aux ligues fascistes des années 1930 (il n’y a pas de défilés militaires ni de militarisation affirmée de la société et, au moins dans son discours, il y a une valorisation de la démocratie), on en conclut qu’elle n’a rien à voir avec le fascisme d’autrefois. À partir de là, on forge des termes qui sont en deçà de la réalité, par exemple ceux de « populisme » ou d’« illibéralisme ».
Ce qui est certain, c’est qu’on a affaire aujourd’hui à des mouvements d’extrême droite qui, quand ils accèdent au pouvoir, s’apparentent au fascisme par leur autoritarisme, leur exploitation des pulsions xénophobes ou racistes et leur nationalisme identitaire comme économique.
L’exemple du trumpisme marque de ce point de vue une accélération prodigieuse. La négation du droit et la censure d’État sur les vérités scientifiques qui dérangent le projet impérialiste des États-Unis sont révélatrices, tout comme les projets annexionnistes (Canada ou Groenland), voire les fantasmes de nettoyage ethnique dans un but capitalistique (le « projet » de faire de Gaza un paradis pour touristes). Il apparaît de plus en plus clairement, avec ce qui se passe aux États-Unis, que les diagnostics en termes de populisme à tendance autoritaire pour caractériser l’extrême droite sont dérisoires.
Le fascisme des années 1930 est né d’une désaffection générale à l’égard de l’idée de démocratie et de la conviction d’une partie des élites que le seul moyen de reprendre la main sur des sociétés ingouvernables était d’utiliser des voies autoritaires. On a trop tendance à ne parler de fascisme qu’à propos de sa forme extrême, le nazisme. On accuse communément la gauche de procéder à une reductio ad hitlerum, mais ce sont souvent les réactionnaires qui utilisent ce procédé pour nous rassurer à peu de frais en montrant que nous sommes loin aujourd’hui de ce genre de dictatures totalitaires.
Il faut également se rappeler que le fascisme a rassemblé des régimes qui ont existé dans divers pays après la Première Guerre mondiale, à commencer par l’Italie, où le terme a été inventé, mais aussi la Hongrie, la Pologne, l’Espagne ou le Portugal. Dans tous les cas, il s’est agi de reprendre en main la société au nom du « vrai peuple » contre des élites jugées perverties et complices des étrangers. Surtout, l’expérience américaine en cours reproduit une dimension centrale du fascisme : un mélange de retour à l’archaïque et d’hypermodernisme technique. S’il y a quelque chose de fasciste aujourd’hui, c’est la synthèse incarnée dans la personne de Musk entre morale religieuse et fantasmes transhumanistes.
On a trop tendance à ne parler de fascisme qu’à propos de sa forme extrême, le nazisme.
À la fois le néo-évangélisme le plus rétrograde, la haine des minorités (LGBT ou raciales), et « l’homme nouveau », le transhumanisme, les rêves de colonisation de la planète Mars, etc. Contrairement à l’extrême droite traditionnelle « antimoderne », le fascisme est une contre-révolution de type « révolutionnaire ». Le culte de la technique, de l’accélération, de la violence numérique se met au service d’un projet fondamentalement réactionnaire et archaïque. Nous sommes en train de vivre, je crois, une nouvelle version de cette synthèse-là, en tout cas aux États-Unis, peut-être avec des retombées futures de ce côté-ci de l’Atlantique.
Le fascisme est-il en train de devenir l’idéologie hégémonique ou dominante (pour reprendre le vocabulaire de Gramsci, décidément très cité de nos jours), après celle du keynésianisme des Trente Glorieuses après-guerre, puis celle (toujous en cours mais peut-être déjà déclinante) du néolibéralisme ?
En ce qui concerne la victoire de l’extrême droite, ce qu’avec Étienne Ollion nous avons appelé son « étrange victoire », nous résistons dans le livre à cette thèse de l’hégémonie culturelle. On a beaucoup dit que l’extrême droite, qu’elle soit états-unienne, italienne ou française, avec des nuances, a d’abord porté le combat au niveau « métapolitique » (comme ses représentants le disent eux-mêmes), c’est-à-dire celui des idées, et qu’elle récolterait aujourd’hui les fruits électoraux d’une bataille culturelle engagée dès les années 1970, outre-Atlantique (avec la « révolution conservatrice ») ou en France (avec les thèses de la « nouvelle droite »).
Or, si on se concentre sur la France, l’extrême droite a, sur un certain nombre de sujets, fait mine d’adopter des points de vue qui étaient ceux de la gauche. Par exemple, les députés RN ont voté majoritairement pour la constitutionnalisation de l’IVG – sur ce point, la différence est marquante avec les États-Unis. Ce qui nous amène à nous demander quelle est la vérité de l’extrême droite contemporaine : est-ce plutôt celle de Donald Trump ou celle de Marine Le Pen ?
En France, la victoire idéologique repose sur ce qu’on appelle la « dédiabolisation ». C’est-à-dire l’abandon des thèmes les moins populaires que l’extrême droite défendait traditionnellement, comme son opposition à l’IVG, au mariage pour tous, ou sa vieille conception hiérarchique du rapport hommes/femmes. Sur tous ces points, il est certain que les ralliements du RN sont de façade, mais cela montre tout de même que l’hégémonie culturelle n’est pas passée magiquement à droite.
Simplement, l’extrême droite a hiérarchisé ses haines, faisant de l’islam le principal ennemi des droits des femmes et même des minorités sexuelles. Elle a renouvelé sa grammaire en l’adaptant aux mutations de la société française, en particulier à l’affaiblissement sociologique du catholicisme. Le plus « étrange » dans cette victoire est qu’elle s’est faite à partir d’une rhétorique dévoyée de la république et des droits de l’homme.
Alors, sur quoi les représentants de l’extrême droite l’ont-ils emporté ?
Ils ont gagné sur deux champs fondamentaux : la question identitaire et celle de l’immigration associée systématiquement à la délinquance. Et là, ils ne l’ont pas fait en militant sur le seul plan des idées, ou « métapolitique ». Ils l’ont fait en surfant sur un prétendu « bon sens », donc plutôt sur ce que l’on peut appeler « l’infrapolitique », en mettant en avant des pseudo-évidences ou des sortes de certitudes difficilement réfutables.
Nous analysons dans le livre le fameux « on est chez nous ! », ce slogan qui rythme chaque meeting du RN (ou de Zemmour) et qui repose justement sur quelque chose d’infra-politique, c’est-à-dire sur les expériences que chacun peut faire d’être dépossédé de son espace quotidien, celles de la transformation de l’urbanisme, de l’environnement, des modes de vie, dont le principal vecteur a été le néolibéralisme.
Le RN, aidé par certains de ses adversaires de papier, a réussi à imposer aux imaginaires que le risque de dépossession venait des étrangers ou des élites corrompues complices de l’immigration. En somme, à faire croire que la cause des difficultés à être « chez soi » était due au squat des étrangers, et non, par exemple, à la financiarisation de l’immobilier qui menace quantité de personnes d’expulsion !
Ce qui signifie que, sur une expérience réelle, la crainte de l’expulsion, de la dépossession, faute de pouvoir payer son loyer ou son prêt, ils ont imposé un imaginaire et construit un « nous » ou un « chez nous » exclusif de toute altérité, transformant l’étranger en principal adversaire, et cela en oubliant les responsabilités du banquier.
En mai 2023, vous déclariez dans Politis (1) : « Il s’agit de comprendre comment une société se “fascise” ou est en état de “préfascistisation”, tout en restant dans un cadre qui demeure d’apparence républicaine. » Où en est-on ?
Politis n° 1756, 4 mai 2023
J’ai bien peur qu’on ait continué dans cette voie de la « fascisation ». Je préfère ce dernier terme à celui de fascisme, qui suppose une unité de doctrine. La fascisation est un processus subjectif fondé sur le désespoir, ou plutôt sur la réduction de l’espérance à une forme de haine. Et nous pouvons hélas en faire l’expérience sans être fasciste : on a tous des moments où, devant les échecs, devant l’impuissance, on opte pour le ressentiment. Pas forcément vis-à-vis de l’immigré, d’ailleurs : ce peut être à l’égard de n’importe quelle catégorie de la population que l’on prend pour bouc émissaire.
La fascisation intervient donc toujours dans des moments de crise qui ne débouchent pas sur un dénouement politique à court ou moyen terme. La crise s’installe et nous sommes actuellement dans une crise généralisée, qu’elle soit politique, économique, sociale ou écologique, sans débouchés qui apparaissent de manière évidente. Aussi, la seule « solution », la plus facilement disponible, est de trouver un bouc émissaire dont la disparition permette le salut. Car le fascisme est toujours lié, historiquement, à ce mélange de crainte apocalyptique et d’espérance de salut.
Aujourd’hui, des espèces de sauveteurs technophiles et fanatiquement identitaires sont déjà au pouvoir aux États-Unis. Mais pour en rester à la France, je crois qu’il y a eu tellement de déceptions, de sentiments de trahison, d’abandon, qu’au fond la solution psychologique la plus simple, c’est de s’abandonner à un sentiment qui apparaît dans cette invraisemblable formule : « Eux, on ne les a pas encore essayés ! » Avec aussi, sur le fond, une certaine amnésie. Par rapport au fascisme, on voit très bien la stratégie de ceux qui ne veulent pas qu’on rappelle l’histoire, avec leur ironie sur « les heures sombres ».
Mais ce sont d’abord eux qui ont rappelé les années 1930, car on a quand même vu, durant ce qu’on appelle la « semaine sainte » dans notre livre, c’est-à-dire la semaine entre les deux tours des législatives de juillet 2024, des candidats du RN se « lâchant » avec des propos racistes, violents et outranciers, d’autres portant des casquettes nazies. Et aux États-Unis, on a vu les saluts nazis chez Musk ou encore plus clairement chez Steve Bannon.
La référence au fascisme, c’est l’extrême droite la plus décomplexée qui la fait. Puis, afin de rassurer ceux qui s’en émeuvent encore, elle nous explique que nous avons mal vu. Je pense souvent à ce propos à la formule de Charles Péguy au moment de l’affaire Dreyfus : « Le plus difficile, ce n’est pas de dire ce que l’on voit, c’est de voir ce que l’on voit. » Non pas que les choses se répètent (comme je l’entendais beaucoup quand j’ai écrit Récidive), car elles ne se répètent jamais à l’identique évidemment. Mais il y a des logiques politiques qui font que le capitalisme, dans des moments de crise, engendre soit des désirs révolutionnaires, soit des pulsions contre-révolutionnaires. Aujourd’hui, c’est plutôt la contre-révolution qui tient la corde.
L’extrême droite a hiérarchisé ses haines, faisant de l’islam le principal ennemi des droits des femmes.
Alors, je ne sais pas si, en France, il y a un risque de fascisme, mais il y a des processus de fascisation. On voit bien que l’extrême droite française tient par tous les moyens à gommer ces références-là. Le bras tendu de Bannon a fait que Bardella a annulé in extremis sa présence à ce meeting américain où tous ses amis étaient présents. L’ironie vertigineuse est que, quelques semaines plus tard, il s’est rendu à une rencontre contre l’antisémitisme en Israël, à l’invitation d’un membre du gouvernement Netanyahou.
Cette schizophrénie est sans doute liée au fait qu’en France nous avons un rapport très différent au fascisme qu’aux États-Unis, parce que ceux-ci en ont été relativement prémunis. En France, nous avons encore une mémoire (de plus en plus affaiblie) de ce que cela a signifié pour nous, c’est-à-dire la défaite et l’humiliation. Alors que Trump n’a pas été obligé de désavouer Bannon après son salut nazi. En France, on a une certaine expérience de ce que fut le fascisme, on a Oradour-sur-Glane et les déportations de juifs avec l’aide de l’administration pétainiste.
Plus généralement en Europe, le fascisme a été notre malheur, avant de finir sous des tapis de bombes. Le cas le plus révélateur est évidemment l’Allemagne, où, en dépit des succès électoraux de l’AfD, la droite ne peut pas s’allier avec l’extrême droite. Pour l’instant, le consensus mémoriel tient encore dans ce pays, mais on voit bien qu’il s’ébrèche. L’adhésion à la démocratie tient beaucoup à la mémoire, mais nous nous rendons compte aujourd’hui à quel point celle-ci est fragile, surtout quand beaucoup s’ingénient à organiser l’amnésie.
De grands historiens spécialistes du XXe siècle s’interrogent sur l’emploi du terme « fasciste » pour qualifier une certaine extrême droite aujourd’hui. À l’instar de Robert Paxton, qui a fini, après des réticences, par accepter d’employer le terme à propos de Donald Trump. Quelle est votre position sur ce terme ?
Comme je l’ai suggéré, pour Trump, je n’hésite pas à l’employer. Là encore, la clé me semble résider dans le rejet viscéral du progressisme issu des Trente Glorieuses, mais au profit d’une technophilie mise au service de la réaction. La question qui se pose est de savoir si la tendance fasciste, ou fascisante, qui domine aux États-Unis, en Argentine avec Milei et aussi en Allemagne avec l’AfD, va l’emporter ou non.
Trump joue à plein la carte de la sidération : il annonce tous les jours une mesure scandaleuse.
Cette question s’est d’ailleurs déjà posée dans les années 1930, puisque l’Espagne avec Franco ou le Portugal avec Salazar étaient plutôt réactionnaires ; s’appuyant sur l’Église catholique et les valeurs traditionnelles, ils différaient du fascisme mussolinien et encore plus du nazisme. Et aujourd’hui, si certains rêvent d’une Internationale fasciste, c’est toujours compliqué chez eux parce qu’ils sont d’abord nationalistes : Trump nous fait une guerre économique, ce qui finit par poser des problèmes à Marine Le Pen ou à Giorgia Meloni !
Aussi, qu’est-il possible de faire contre ce renouveau fasciste, ou fascisant ?
Tout d’abord, expliquer son fonctionnement et sortir de cet « état de sidération » dont nous parlons dans le livre et qui participe de la victoire de l’extrême droite. Trump joue à plein la carte de la sidération : il annonce tous les jours une mesure scandaleuse ou fait une provocation dans le but d’empêcher toute opposition construite. Il s’agit donc d’essayer de comprendre que l’imprévisibilité des discours de l’extrême droite n’est pas si imprévisible et qu’il y a là une logique.
Car la logique de Trump est aussi celle d’une prédation économique, qui est une des voies de salut dictatoriales, depuis l’accaparement des terres rares en Ukraine jusqu’à ses prétentions sur le Groenland. C’est l’une des voies de salut dictatoriales du grand capital nationaliste, pour employer un vocable ancien !
Et il faut bien comprendre, je crois, que cela traduit une évolution du capitalisme, notamment la fin du néolibéralisme (qui pouvait, lui aussi, être autoritaire) ou du libre-échangisme – Macron est l’un des derniers à encore y croire. Nous sommes maintenant entrés dans un autre âge du capitalisme, un capitalisme national, compétitif entre États, inter-impérialiste, autoritaire, qui n’est plus dans le libre-échangisme triomphant et indique sans doute la fin de la globalisation « heureuse » par le seul commerce.
Le néolibéralisme entraînait tout le monde dans la fiction d’une concurrence économique qui ne finissait jamais en violence. Or, aujourd’hui, il semble bien qu’on entre dans le réel de l’histoire, et que la guerre soit l’horizon de ces luttes économiques entre capitaux et pour le profit. C’est cette configuration qu’il faut affronter en montrant inlassablement qu’elle mène à la violence et à la ruine de la démocratie.
Pour aller plus loin…

Rose Lamy : « La gauche doit renouer avec ceux qu’elle considère comme des ‘beaufs’ »

Didier Lestrade : « On assiste à des retours en arrière effroyables »

Julie Couturier : « Attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie »