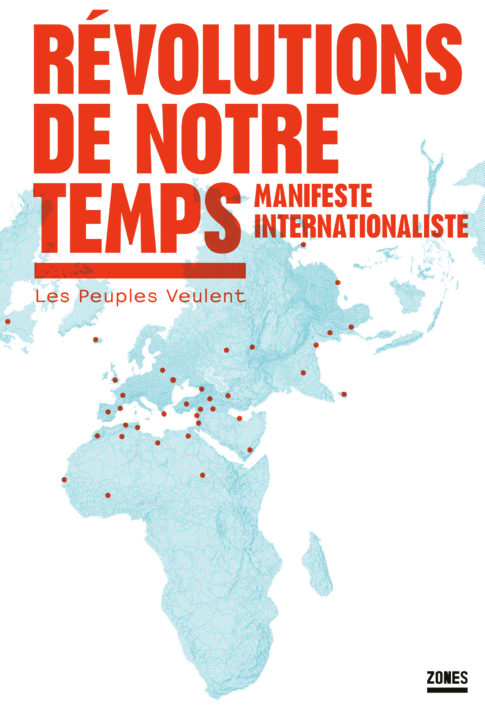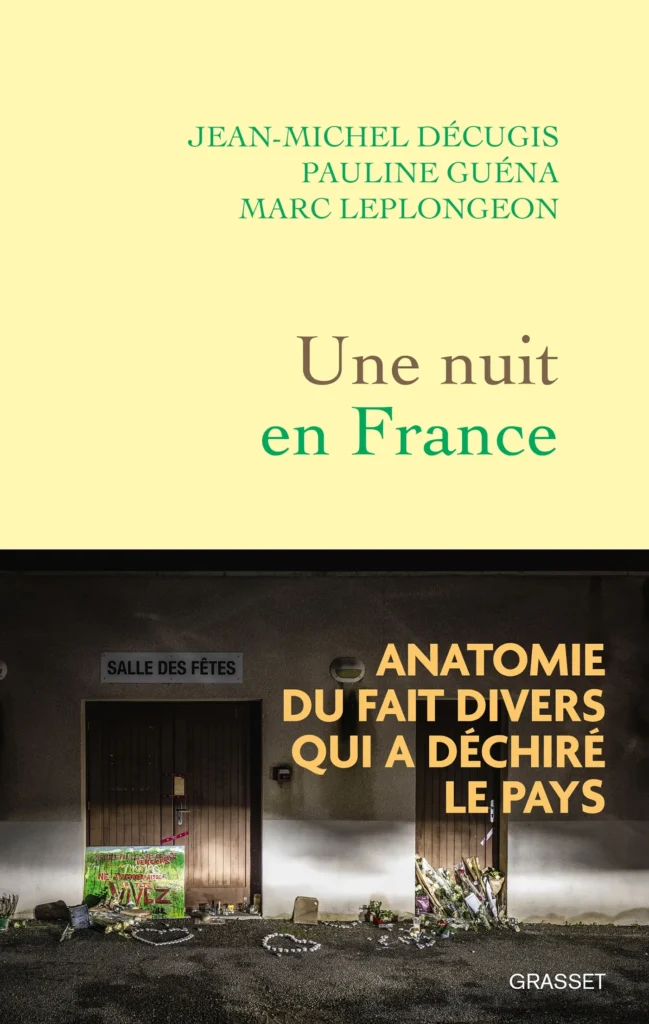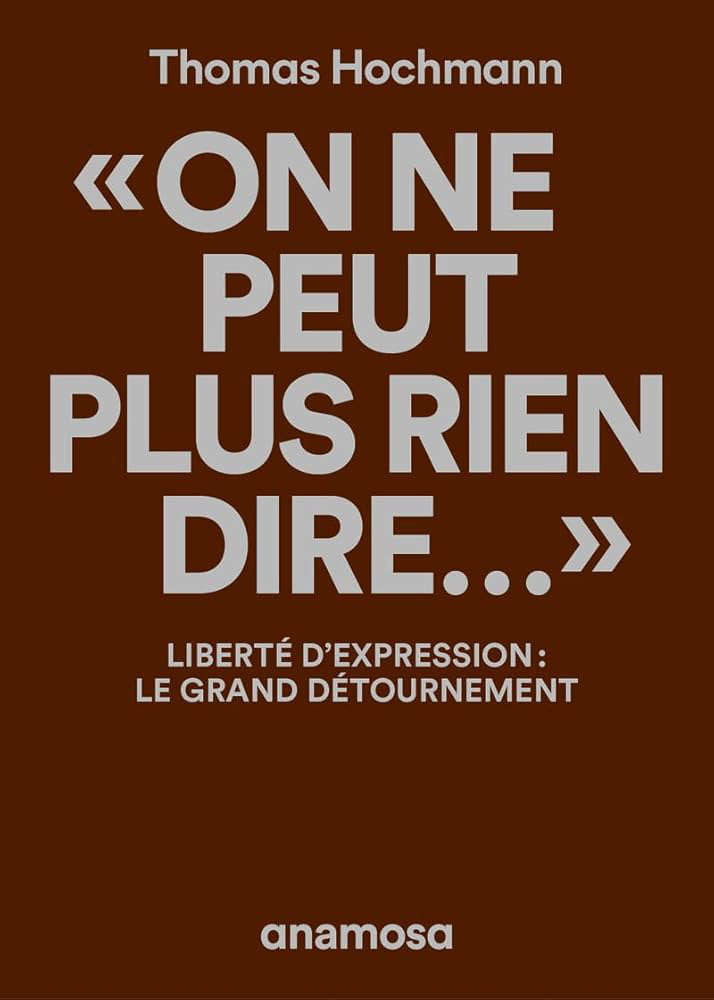Contre le fascisme, un printemps des peuples ?
Loin de marquer la fin de l’histoire, notre millénaire tremble des révoltes qui éclatent partout dans le monde. Un manifeste collectif, fruit de discussions transcontinentales, tente d’en tirer des leçons pour un avenir révolutionnaire.
dans l’hebdo N° 1857 Acheter ce numéro

Révolutions de notre temps. Manifeste internationaliste, collectif Les Peuples Veulent, Zones, 128 pages, 15,50 euros.
Tout commence en banlieue parisienne en 2019, lorsque des révolutionnaires en exil et des militants locaux créent la Cantine syrienne. Un lieu d’échanges et d’amitiés politiques donnant naissance à un réseau qui s’internationalise rapidement : Les Peuples veulent. En 2023, les discussions se muent en un projet d’écriture collectif qui traverse les océans pour donner naissance au Manifeste internationaliste.
Fort des luttes menées depuis un quart de siècle, de leurs mémoires et de leurs expériences, de leurs succès et de leurs revers, le réseau propose des chemins pour faire avancer la cause révolutionnaire, celle du pouvoir populaire qui, partout, est encadré, enchaîné et combattu. Les avant-gardes du siècle passées ne sont plus de mises, pas plus que le Grand Soir : il n’y a pas de modèle à fétichiser, pas d’épiphanie à attendre. « El tiempo de la revolución es ahora , clament les féministes argentines : « Le temps de la révolution, c’est maintenant », dans l’accumulation des combats et l’élargissement des causes.
La constitution d’une « culture révolutionnaire transnationale », encore appelée « internationalisme populaire non aligné », ne va pas sans embûches. L’expérience parle, et le manifeste se garde des raccourcis et simplifications du réel. La création d’un réseau par-delà les continents soulève la question des modalités d’aide possibles. L’humanitaire, mené par les États et les ONG, tend à maintenir les dominations et à imposer des formes d’organisations aux peuples. L’arrivée des associations en Palestine après les accords d’Oslo balaie ainsi l’auto-organisation populaire qui préexistait.
Entraide joyeuse et horizontale
Le manifeste invite à s’inspirer de la pratique du minga en Abya Yala, nom donné par les peuples autochtones au continent américain : une entraide joyeuse, horizontale et fondée sur des solidarités locales. Pour traverser néanmoins les frontières, la résistance birmane offre l’exemple du crowdfunding, qui permet de financer directement la lutte. Contourner les canaux médiatiques et travailler à la visibilité des soulèvements, bloquer les usines d’armement sont encore d’autres modalités de solidarité transnationale.
Il faut investir les soulèvements populaires chaque fois qu’ils se présentent et se garder de toute prétention à la « pureté ».
Une solidarité qui doit se départir des préférences entre impérialismes : on ne soutient pas la Chine contre les Ouïghours ou l’Iran contre les femmes luttant pour « Jin, Jiyan, Azadî » (« Femme, Vie, Liberté ») au nom du combat contre la puissance états-unienne. L’Empire, notre monde capitaliste et globalisé, dépasse le seul Occident.
La lutte n’est pas seulement un produit d’exportation : il faut investir les soulèvements populaires chaque fois qu’ils se présentent et se garder de toute prétention à la « pureté ». Le souci de l’autonomie au nom de l’éthique révolutionnaire ne doit pas conduire à l’entre-soi, sans pour autant que l’intégration aux luttes ne signifie de se compromettre avec des objectifs électoraux et institutionnels. C’est bien la convergence entre les organisations autochtones, les syndicats et des millions de citoyens qui a permis la victoire contre le gouvernement équatorien en 2019.
Des dilemmes n’en existent pas moins : s’organiser pour mieux lutter au risque de se bureaucratiser, prendre les armes pour faire face aux gouvernements et seigneurs de guerre au risque de se militariser… Maintenir le pouvoir populaire contre les vents mauvais de la répression implique d’accepter le réel sans se faire engloutir par les outils. Be water, my friend (« Sois comme l’eau, mon ami·e »), conseillaient les révolutionnaires hongkongais. Pourtant, l’auto-organisation populaire et révolutionnaire ne se maintient que rarement, les comités de résistance soudanais constituant l’exception.
La liste et la carte des soulèvements, proposées en début d’ouvrage, nous invitent donc à porter notre regard au-delà des frontières, comme vers autant d’étoiles qui n’attendent que de former des constellations révolutionnaires. À quand de nouveaux astres ?
Les parutions de la semaine
En finir avec les présidents, Olivier Besancenot, Seuil, « Libelle », 60 pages, 4,90 euros.
Dès le lendemain de l’élection présidentielle, le 21 avril 2022, la classe politique avait les yeux tournés vers la présidentielle de 2027. Un quinquennat, c’est court. Et ça n’aide pas à déprésidentialiser l’agenda politique français, estime Olivier Besancenot. L’ancien double candidat à l’élection présidentielle, militant du NPA, dresse un tableau critique de nos institutions : de la déconnexion du palais de l’Élysée jusqu’à la « cour parlementaire ». Convaincu que les jours de la Ve République sont comptés, Besancenot livre ici ses réflexions sur ce que pourrait être une Convention constituante. Et enfin « passer d’objet de domination à sujet d’émancipation ». Inspirant.
Une nuit en France, Jean-Michel Décugis, Pauline Guéna et Marc Leplongeon, Grasset, 208 pages, 20 euros.
Longtemps, les rapaces racistes ont tourné au-dessus de Crépol. Identitaires, élu·es du Rassemblement national et autres partisans de la guerre civile ont pensé voir, dans la mort de Thomas, 16 ans, tué à l’arme blanche à la fin d’un bal de ce village isérois, le 19 novembre 2023, le festin de leur funeste idéologie. Mais il n’en était rien. C’est ce que montrent les journalistes Jean-Michel Décugis, Pauline Guéna et Marc Leplongeon dans Une nuit en France. Cette plongée, rigoureuse et haletante, donne un écho intéressant au combat mené par des habitant·es de Crépol et des alentours qui tentent de panser, aujourd’hui, les blessures laissées par cette fameuse nuit.
On ne peut plus rien dire. Liberté d’expression : le grand retournement, Thomas Horchmann, Anamosa, 69 pages, 5 euros.
C’est avec ironie que Thomas Hochmann a pris pour titre de son essai cursif et utile cette plainte récurrente : « On ne peut plus rien dire… » En juriste et en multipliant les exemples, d’Éric Zemmour à Cyril Hanouna, il démonte, pour les combattre, les arguties de l’extrême droite et de ses suiveurs quand ils utilisent la notion de « liberté d’expression » en la dépouillant de son contenu. Thomas Hochmann montre efficacement combien les limites posées par le droit protègent en réalité l’exercice de cette liberté et ne sont en rien des censures. « Le libre échange des opinions a besoin d’une base factuelle partagée », rappelle-t-il également, à l’heure de la désinformation. Il aborde enfin les questions sensibles liées à l’antisémitisme et à l’islamophobie.
Pour aller plus loin…

Julie Couturier : « Attaquer l’État de droit, c’est attaquer la démocratie »

« La science est la meilleure alliée des luttes pour la santé environnementale »

Cette encombrante démocratie