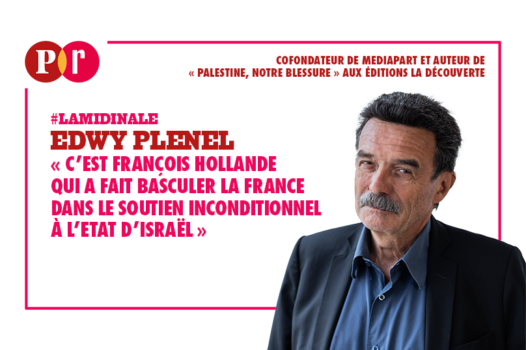À Berlin, les Turcs sous la menace de l’extrême droite
Après une campagne électorale éclair dominée par le thème de l’immigration, la communauté turque d’Allemagne fait les frais de la montée des discours xénophobes et du durcissement des politiques migratoires, promis par la coalition en voie de former le prochain gouvernement.
dans l’hebdo N° 1856 Acheter ce numéro

© Christoph Soeder / dpa / AFP
Le soir du 23 février, Hacı-Halil Uslucan se rend chez des amis pour suivre les résultats des élections en direct, à la télévision. « Je me suis demandé si je devais apporter mes valises », ironise-t-il avec le sérieux que lui confèrent ses rôles de professeur à l’université de Duisburg-Essen et de directeur de la Fondation pour les études turques et la recherche sur l’intégration (ZfTI), habitué à peser ses mots.
Pour lui comme pour environ 2,9 millions de personnes d’origine turque en Allemagne, les résultats des élections législatives anticipées ont de quoi susciter l’anxiété : les chrétiens conservateurs de la CDU/CSU sont arrivés en tête du scrutin avec 28,6 % des suffrages, tandis que le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) s’est, lui, hissé en deuxième position (20,8 %), obtenant le meilleur score enregistré par l’extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale.
La CDU/CSU et son chef Friedrich Merz, probable successeur du chancelier Olaf Scholz, ont notamment annoncé vouloir durcir les contrôles aux frontières, suspendre la réunification familiale pour les détenteurs de la protection subsidiaire, et évaluent la possibilité de révoquer la citoyenneté allemande des binationaux considérés comme « extrémistes » ou « antisémites ».
Bien qu’ils aient réfuté toute alliance avec l’extrême droite en marge de leur victoire aux élections, les conservateurs ont été accusés de rompre le « cordon sanitaire » en votant, fin janvier, une motion parlementaire sur l’immigration avec l’appui de l’AfD. Un climat politique aux répercussions sociales tangibles, estime Hacı-Halil Uslucan, pour qui « les discriminations sont pires que jamais ».
Éternellement étrangers
À mesure que refroidit la tasse de café posée devant lui, une autre amertume infuse le récit du professeur, dépliant le fil d’une histoire à la fois familiale et collective : en 1973, il est âgé de 13 ans lorsqu’il quitte la Turquie pour rejoindre son père à Berlin, arrivé deux ans plus tôt via le programme des gastarbeiter, les « travailleurs invités ».
Tant qu’il y a des besoins, ils acceptent les gens comme nous. Sinon, ils trouveront toujours le moyen de nous recaler.
Ş. Bilgi
Contrairement à ses voisins – à commencer par la France –, la République fédérale d’Allemagne (RFA) ne peut pas compter sur ses colonies pour répondre aux besoins de main-d’œuvre prescrits par la reconstruction et l’économie d’après-guerre florissante. En 1955, une série d’accords bilatéraux sont signés avec des pays d’Europe du Sud, et le programme s’élargit en 1961, entre autres, à la Turquie. Ses ressortissants deviennent vite les plus représentés parmi les gastarbeiter, puis la plus large minorité ethnique d’Allemagne de l’Ouest.
Arrive le premier choc pétrolier. L’économie est plombée, le chômage se répand et, en 1973, les autorités mettent un frein aux recrutements. À Berlin et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où la communauté turque est désormais bien implantée, il n’est pourtant pas question de plier bagage. Temporaire sur le papier, la « présence turque » devient permanente. Pourtant, même après plus de soixante ans d’histoire commune, « nous sommes toujours perçus comme des étrangers », constate à regret Hacı-Halil Uslucan.
Un quotidien limité par la peur
Dans les locaux de l’Association des femmes turques de Berlin, où elle s’implique depuis l’adolescence, Şemsi Bilgi, 59 ans, reste souriante malgré les menaces croissantes auxquelles est exposée sa communauté. Les attaques à caractère islamophobe sont en forte hausse en Allemagne, d’après un rapport de l’association internationale Claim de 2024.
Les personnes perçues comme turques ou arabes seraient plus susceptibles de subir du racisme et des discriminations par rapport à d’autres personnes d’origine étrangère, selon une étude menée par le Commissariat à la migration, aux réfugiés et à l’intégration et le Commissariat à l’antiracisme. Une situation qui n’est pas sans rappeler la décennie 1990, durant laquelle la fréquence des attaques de néonazis dans le pays fraîchement réunifié lui a valu le surnom « années batte de baseball ».
Aujourd’hui, Şemsi Bilgi décrit un quotidien toujours limité par la peur de s’exposer au racisme de ses concitoyens. Elle n’est d’ailleurs pas la seule à raconter éviter le plus possible les transports en commun, voire de sortir des arrondissements de Kreuzberg et Neukölln, où s’est concentrée historiquement une grande partie de la population turque.
« Mon salaire est le double de celui que touchaient mes parents », anciens gastarbeiter, « mais j’ai toujours du mal à trouver un logement, juste à cause de mon nom », confie celle qui travaille comme informaticienne au sein d’une compagnie d’assurances. Plusieurs secteurs de l’économie allemande dépendent pourtant de la main-d’œuvre étrangère, rappelle Şemsi Bilgi, désabusée : « Tant qu’il y a des besoins, ils acceptent les gens comme nous. Sinon, ils trouveront toujours le moyen de nous recaler. »
L’avenir en suspens
Le cercle vicieux des discriminations menant à l’exclusion économique et sociale, Fatih Kanalici, 43 ans, l’observe aussi chez « les Allemands blancs paupérisés qui adhèrent aux idées de l’extrême droite ». Lui-même admet avoir dû confronter ses préjugés envers les « travailleurs invités » turcs et leurs descendants en s’installant à Berlin, il y a sept ans.
Il est de la nouvelle vague d’immigration turque, survenue après la tentative de coup d’État de 2016 et le resserrement autoritaire qui a suivi. Dans son ancienne vie stambouliote, l’ex-journaliste reconnaît ne pas avoir été imperméable aux a priori négatifs largement répandus à l’égard des almancılar, appellation péjorative donnée aux « Turcs d’Allemagne » en Turquie.
Beaucoup ont peur de devoir partir.
A. Demir
Le travailleur social témoigne désormais de leurs difficultés en première ligne. Dans la foulée des élections, Fatih Kanalici constate une hausse importante du nombre de personnes qui cognent à la porte de son organisme, pressées d’obtenir de l’aide dans leurs démarches pour obtenir la citoyenneté. L’accès à la double nationalité a été facilité par une réforme entrée en vigueur en juin 2024.
Une mesure remise en cause par la CDU/CSU, qui a dû céder sur ce terrain lors de ses négociations avec le Parti social-démocrate (SPD) en vue de former le futur gouvernement. Même son de cloche dans les bureaux de la Fédération turque de Berlin-Brandenburg (TBB), où Ayşe Demir lâche : « Beaucoup ont peur de devoir partir. »
L’an dernier, des révélations sur la réunion secrète tenue entre des militants néonazis, des cadres de l’AfD et des membres de l’aile droite de la CDU autour du projet de « remigration » avaient provoqué une onde de choc au pays. Mais, pour la communauté turque, l’événement n’est pas sans rappeler une loi de 1983 proposant une somme incitative aux gastarbeiter pour qu’ils retournent dans leur pays d’origine. À l’époque, « ceux qui voulaient rester ont pu le faire », se remémore la porte-parole de la TBB. Cette fois, elle redoute de ne pas avoir le choix qu’ont eu ses parents à l’époque.
« J’ai senti qu’on m’enlevait mon pays »
L’étau se resserre aussi autour des réfugiés et des demandeurs d’asile, parmi lesquels la Turquie est le troisième pays de provenance en 2024, après la Syrie et l’Afghanistan. Dix ans après la « crise des migrants », l’Allemagne semble en effet bien loin du temps où l’ex-chancelière Angela Merkel ouvrait les frontières à un million de Syriens réclamant une protection internationale.
La montée de l’extrême droite et le durcissement des politiques migratoires déjà en cours en seraient le contrecoup, analyse l’historien Brian Van Wick. Pas étonnant non plus de voir l’AfD et son idéologie raciste et xénophobe monter en flèche, dit-il, rappelant la « longue continuité idéologique et organisationnelle de l’extrême droite en Allemagne ».
Nous recevions déjà des menaces, bien sûr. Mais, maintenant, les gens signent leurs lettres de haine.
A. Demir
Avec la montée en puissance du parti, consacré lors des législatives de février, une rupture a bel et bien été actée confirme Ayşe Demir : « Le soir des élections, j’ai senti qu’on m’enlevait mon pays. » « Nous recevions déjà des menaces, bien sûr. Mais, maintenant, les gens signent leurs lettres de haine », poursuit-elle, à mi-chemin entre effroi et combativité. Et si elle ne manque pas de mots pour dénoncer le climat actuel, la peur et la précarisation qui accablent la communauté turque, sa parole devient fleuve lorsqu’elle raconte une enfance dans l’intimité des rues et des maisons de Kreuzberg, bercée par la solidarité.
Pour aller plus loin…

Un des réalisateurs de « No Other Land » attaqué par des colons, couverts par l’armée israélienne

« Le retour des prisonniers politiques peut être la clef d’une réforme de la société palestinienne »

Bande de Gaza : la guerre, toujours