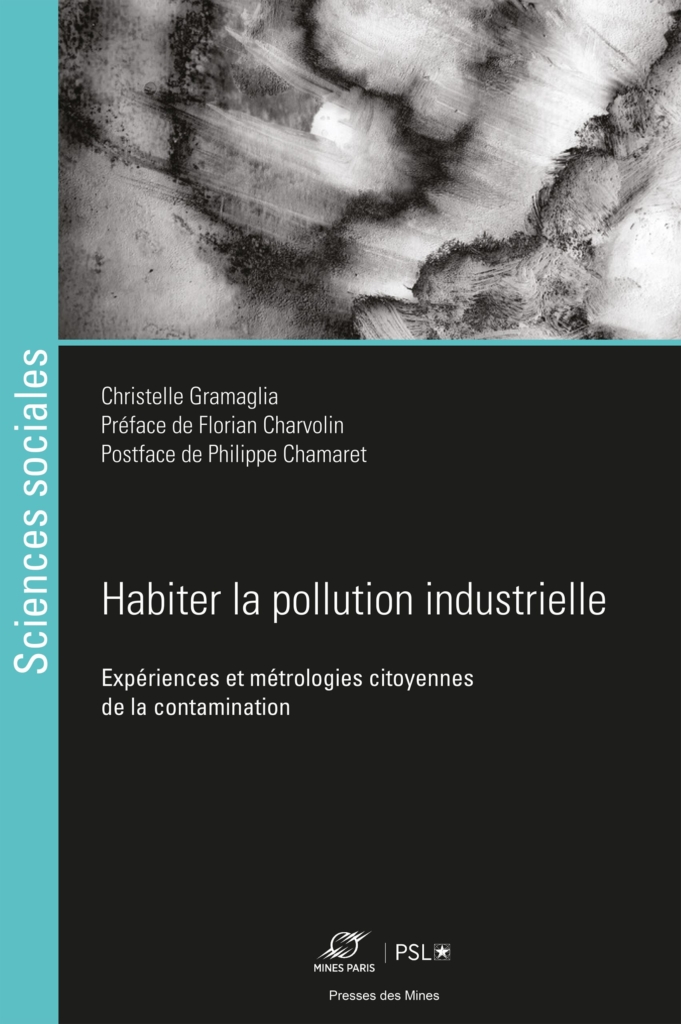Une démocratie locale pour la santé
À l’heure où les régulateurs de l’environnement sont remis en cause au nom de l’économie, les instituts et les observatoires écocitoyens réinvestissent le vide d’information et de débat sur la santé environnementale dans des territoires pollués.
dans l’hebdo N° 1858 Acheter ce numéro

© Arnaud Chochon / Hans Lucas / AFP
Dans le même dossier…
« Les citoyens permettent aux scientifiques d’avoir le bruit du territoire » En Loire-Atlantique, la lumière sur un foyer de cancers pédiatriquesCe n’est pas tous les jours qu’on cite un pêcheur dans un article scientifique. Et pourtant, Jacques Carle peut s’enorgueillir de figurer dans plusieurs publications portant sur les polluants de l’étang de Berre (Bouches-du-Rhône). Ce riverain s’est montré inquiet de l’installation d’un incinérateur, et ce sont ses connaissances en tant que pêcheur qui ont été mises à contribution par les toxicologues pour choisir le meilleur indicateur biologique de pollution dans cette étendue d’eau cernée d’usines : le congre, prédateur majeur des poissons locaux, qui s’érige en bout de chaîne alimentaire, où se concentrent les métaux lourds recherchés.
Cette méthode de recherche considérée comme « trop locale » par les organismes de veille sanitaire a vu le jour grâce à la collaboration inattendue des pêcheurs de loisir et des scientifiques de l’Institut écocitoyen (IEC) de Fos-Étang de Berre. Créée il y a plus de dix ans, cette association est la pionnière d’une forme d’organisation démocratique environnementale locale qui a essaimé en Provence, dans la vallée du Rhône, sur la façade Atlantique et même à l’étranger, en Espagne ou au Sénégal.
Les collectivités sont responsables sur plusieurs aspects de la santé des habitant·es (…) mais n’ont aucune capacité à agir sur les sources potentielles de pollution.
D. Favre
Depuis les années 2010, des membres de la communauté scientifique apportent leur expertise pour problématiser des questionnements liés à la santé environnementale, comblant ainsi un vide d’information ou un manque d’écoute du pouvoir central. Plusieurs années de persévérance politique qui brisent le scénario habituel de la disqualification des luttes écologiques.
Au départ, il y a toujours une alerte qui réveille le débat local sur une pollution aiguë connue, mais balayée sous le tapis du tissu économique. Dans le cas de la vallée de l’Arve (Haute-Savoie), la révolte s’est élevée à la suite d’un brouillard de pollution étouffant à l’hiver 2016-2017 : « Il y a dans la vallée un triptyque infernal : industrie lourde, chauffage résidentiel au bois et effet de cuvette, énumère Marine Denis, directrice de l’IEC du Pays du Mont-Blanc, fraîchement créé. Mais les autorités sanitaires sont loin. L’agence régionale de santé la plus proche est à Lyon, et il y a une défiance forte vis-à-vis des institutions. »
Durant le pic de pollution qui a embrumé l’agglomération, les cours d’école ont été interdites aux enfants, le vélo découragé. Le phénomène a été alimenté par une question centrale : quels sont les risques pour la santé ? Et là, vertige : la plupart des élu·es n’en avaient pas la moindre idée. « Il y a ce paradoxe : les collectivités sont responsables sur plusieurs aspects de la santé des habitant·es, notamment l’eau potable, mais n’ont aucune capacité à agir sur les sources potentielles de pollution, pointe Delphine Favre, déléguée générale de l’Association nationale des collectivités pour la maîtrise des pollutions et risques industriels (Amaris). Ce qui déclenche l’action des collectivités territoriales, c’est l’action citoyenne. »
Les collectivités territoriales isolées déploient leurs petits moyens – comme un plan de protection de l’atmosphère autour du mont Blanc – mais la discussion n’a pas lieu. Faute d’un service dédié, faute de compétences locales, faute d’une table et de chaises autour desquelles asseoir le débat.
Collaboration citoyenne et scientifique
Dans ce silence pesant, les associations multiplient les demandes d’informations environnementales auprès des Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), d’études sanitaires auprès des agences régionales de santé (ARS). Malgré la spécificité de chaque terrain, la réponse de ces administrations est toujours la même : le cadrage d’une « science réglementaire ». Pointant les biais du territoire, diluant les cas critiques dans les cohortes et écrêtant les pics par des moyennes, les études de cette méthode d’évaluation concluent généralement à des phénomènes isolés, non pertinents. Des résultats souvent contestés par les collectifs qui en demandent la communication, en vain.
« Depuis vingt-cinq ans que nous travaillons à accompagner des associations sur des questionnements épidémiologiques, nous n’avons eu qu’un seul cas où les études ont reconnu un lien : c’était à Aulnay-sous-Bois, où des dizaines de personnes avaient déclaré un mésothélium à proximité d’une usine d’amiante, synthétise Me François Lafforgue, avocat spécialisé en santé environnementale. Quand des demandes d’information sont faites, la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) nous donne toujours raison. Mais les autorités ne donnent pas suite et nous ne pouvons pas lancer les procédures pour pointer les responsabilités. »
Pour obtenir les données sur les pollutions industrielles de la zone de Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique) et les extraits du registre des cancers, l’avocat a déposé la première demande en janvier 2023, et reçu un avis favorable de la Cada en août. Portée devant le tribunal administratif de Nantes, cette requête est restée sans suite depuis deux ans.
Pour combler ce vide, les instituts envisagent de produire leurs propres données avec des membres allié·es au sein de la communauté scientifique. Loin des exigences de neutralité, les citoyen·nes orientent le protocole vers les points chauds et pertinents : zone de dispersion des fumées d’usine, terrains industriels mal dépollués, populations les plus exposées…
Nous souffrons avec les autorités sanitaires d’une science hors sol qui vise à généraliser.
C. Gramaglia
Venu dans la grande banlieue de Dakar en suivant la piste du recyclage de déchets, l’anthropologue des techniques Yann Philippe Tastevin a été interpellé par les riverain·es enfumé·es par les usines qu’il étudiait : « J’ai découvert un vrai ‘siège sensoriel’ : les fenêtres fermées, la cueillette interdite… Les fumées, les poussières, les odeurs, tout était très bien caractérisé par les riverains. Ils nous ont guidés pour installer des biocapteurs en écorce, qui permettent de mesurer les polluants dans l’air. Nous sommes devenus des médiateurs plutôt que des sachants. »
L’expérience n’est pas sans racines. En France, la sociologue Annie Thébaud-Mony accompagne depuis 2002, au sein du Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle (Giscop), les malades exposé·es aux toxiques dans l’exercice de leur métier en Seine-Saint-Denis, et depuis 2017, dans le Vaucluse. Autrice d’Habiter la pollution industrielle (1), la sociologue Christelle Gramaglia trace une perspective politique de ces hybridations entre méthode scientifique et savoirs populaires.
Habiter la pollution industrielle. Expériences et métrologies citoyennes de la contamination, Christelle Gramaglia, éditions Presses des mines, 2023.
« Nous souffrons avec les autorités sanitaires d’une science hors sol qui vise à généraliser. Isabelle Stengers a étudié la façon dont la quantification moderne disqualifie les témoignages et les vécus, analyse la sociologue. À l’inverse, le travail au plus près transforme la façon de faire des sciences, nous basculons dans une relation comme le décrit Donna Haraway. Je pense que c’est une forme d’environnementalisme des classes populaires. »
La politique de l’autruche des autorités sanitaires
Face à une surconcentration des cancers pédiatriques dans le nord de la Charente-Maritime, l’association Avenir santé environnement 17 (ASE 17), fondée en 2018, a assemblé pièce par pièce pendant trois ans les moyens financiers et humains pour réaliser une étude épidémiologique « citoyenne ». L’étude des prélèvements réalisés sur 70 enfants du secteur révèle la présence de 45 polluants différents dans les cheveux et 14 dans les urines.
La première réaction de l’ARS était de refuser de commenter un résultat qui, d’après elle, n’avait rien de scientifique.
F. Rinchet-Girollet
Dans la liste clignotent le phtalimide, produit de dégradation du folpel, fongicide interdit car classé cancérogène, mutagène et reprotoxique, et le pendiméthaline, herbicide associé à des risques de cancer. Ces résultats explosifs lancés dans le débat public à l’automne 2024 ont fait pschitt. « La première réaction de l’ARS était de refuser de commenter un résultat qui, d’après elle, n’avait rien de scientifique, se souvient, écœuré, Franck Rinchet-Girollet, père d’un enfant malade et porte-parole d’ASE 17. Le préfet nous a invités avec des représentants de l’ARS et une petite dizaine de maires. Mais la chambre d’agriculture n’a pas bougé, les autorités sanitaires ne donnent pas suite, donc nous allons avoir une période d’épandage de pesticide en plus. »
Régulièrement remontés à l’Assemblée nationale, ces constats de terrain sont écartés de la même main. Questionnée à ce sujet par le député écologiste Jean-Claude Raux en octobre 2024, la ministre de l’Agriculture a rétorqué : « Il faut analyser les résultats locaux à la lumière des études nationales approfondies déjà menées afin de savoir de quoi l’on parle, d’établir les liens de cause à effet. » « Dire que nous ne sommes pas sûrs, c’est la politique de l’autruche, résume le député de Loire-Atlantique. C’est aussi comme ça que nous avons laissé passer dix ans entre l’expiration de l’autorisation de l’herbicide flufénacet et son interdiction. Entre-temps, son usage avait été multiplié par quatre ! »
Sur le territoire, la succession d’escarmouches entre citoyen·nes mobilisé·es, collectivités hésitantes, représentant·es d’intérêts sur la défensive et administrations frileuses confine au blocage. Verrou central du débat : les causes probables des pollutions s’ancrent là où se joue la survie économique locale. Tourisme dans les Alpes, chimie dans l’étang de Berre, agriculture intensive dans les plaines charentaises… L’institut citoyen apparaît dès lors comme le lieu de la conciliation et du débat, dont le pouvoir central prive l’échelle locale. Aux côtés des citoyen·nes engagé·es, des scientifiques allié·es et des élu·es, l’invitation des industriels ou des responsables économiques s’impose.
Les élu·es pris en étau entre associations et intérêts économiques se mettent du côté de l’emploi.
V. Thivent
« Il y a très peu d’emplois dans l’Aude. Or, les secteurs pointés par les pollutions font vivre le territoire : Orano à Narbonne, les cimentiers à Port-la-Nouvelle, la viticulture dans les coteaux, trace Viviane Thivent, conseillère municipale à Narbonne et présidente de l’Institut écocitoyen de l’Aude. Les élu·es pris en étau entre associations et intérêts économiques se mettent du côté de l’emploi. C’est pour ça que l’institut est essentiel : nous avons un collège par groupe, nous importons le rapport de force dans la structure. » Réunis sous l’égide des collectivités territoriales, souvent avec leurs budgets, les instituts et observatoires présentent leurs conclusions avec une crédibilité toute différente auprès des instances.
Ces associations développent des zones de concertation où la réflexion scientifique est mise au service direct des problématiques locales. Enseignant chercheur en neurophysiologie à Nantes, Mickaël Derangeon a réuni les deux rives de la science et de la politique en se présentant aux élections municipales dans la continuité de son engagement face au cluster de cancers pédiatriques de Sainte-Pazanne. « C’est une forme de lutte contre l’obscurantisme. Je suis avant tout fonctionnaire : passer le savoir, c’est dans ma mission, affirme-t-il avec émotion. Les scientifiques ont été déconnectés du terrain, les citoyen·nes transformé·es en consommateurs de la politique… Ce qu’on prouve là, c’est qu’on a un pouvoir d’action incroyable. »
Pour aller plus loin…

« Les citoyens permettent aux scientifiques d’avoir le bruit du territoire »

En Loire-Atlantique, la lumière sur un foyer de cancers pédiatriques

« J’essayais de faire au mieux, sans penser aux conséquences pour moi »