La mauvaise foi basée sur les preuves
Docteur BB répond à Franck Ramus, directeur de recherches au CNRS, critique des approches psychanalytiques dans le coin psychiatrique.
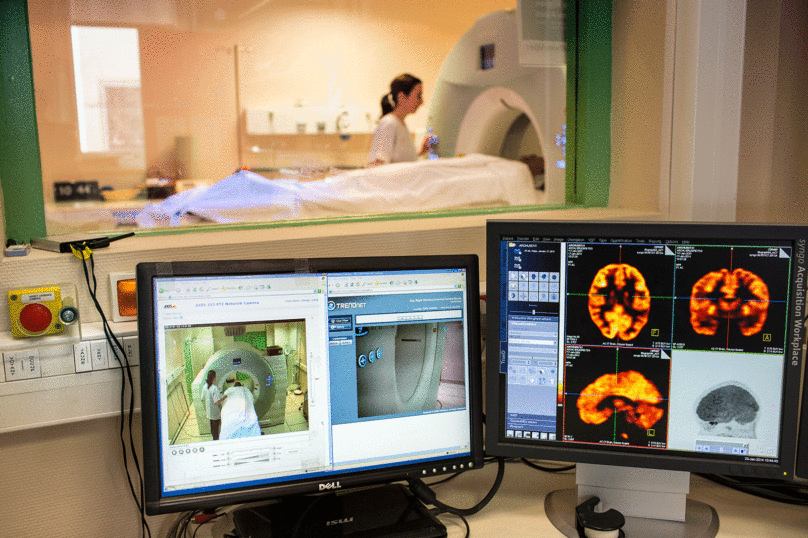
Cherchant à consulter le site du collectif des 39 à propos de la journée nationale de la psychiatrie du 22 janvier, je suis tombé par hasard sur cette tribune datant de mai 2014 qui m’a irrité au plus haut point.
La condescendance et le mépris affiché à l’égard de psychiatres engagés au quotidien dans le soin a attisé une colère certaine et m’a donné envie de réagir, en pensant que ce débat illustrerait de façon éclairante certains enjeux actuels autour de la psychiatrie. En arrière-plan, ce sont effectivement les modèles des soins psychiques qui se trouvent interrogés, à la fois dans leur dimension théorique et pratique, ainsi que par rapport aux orientations prioritaires en termes de financement public.
Certes, la tribune en question est un peu datée : écrite par Franck Ramus, elle a été publiée en mai 2014 sur le blog Mediapart de Jean-Louis Racca, à thématique très anti-psychanalytique. Mais je crois que, en dépit d’un certain anachronisme, les enjeux qui y transparaissent sont toujours d’actualité, et que ce texte polémique illustre parfaitement la teneur parfois passionnelle et décomplexée des conflits qui déchirent la psychiatrie contemporaine : place de la recherche scientifique et des exigences de preuves, prépondérance des neurosciences cognitives, influence des sciences humaines, et notamment de la psychanalyse, préoccupation éthique, ingérence administrative, rationalité des politiques sanitaires, dimension sécuritaire, instrumentalisation de la clinique, etc.
D’abord, qu’est-ce le collectif des 39 ? Il s’agit d’un mouvement qui est né face aux attaques de plus en plus récurrentes à l’égard d’une conception humaniste du soin psychique, héritée d’une longue tradition clinique et émancipatrice.
La charte de ce mouvement explicite tout à fait le positionnement du collectif, luttant pour une clinique relationnelle et respectueuse de la singularité des patients, tout en affirmant son refus des dérives stigmatisantes ou sécuritaires d’une psychiatrie instrumentalisée.
C’est justement ce texte qui permet à M. Franck Ramus de déployer une critique acerbe de la psychiatrie institutionnelle et des influences de la psychanalyse sur cette culture du soin.
Alors déjà, de quelle place s’exprime ce contradicteur ?
M. Franck Ramus est directeur de recherche au CNRS et professeur attaché à l’ENS. Il travaille au Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique, dirigeant l’équipe « développement cognitif et pathologie ». Il est également membre du conseil scientifique de l’Éducation nationale. Ses recherches portent sur le développement cognitif de l’enfant, ses troubles (dyslexie développementale, trouble spécifique du langage, autisme), ses bases cognitives et cérébrales, et ses déterminants génétiques et environnementaux. Comme il le précise lui-même sur son site, il n’est pas médecin, ni psychologue, n’a aucune expérience clinique ni pratique du soin.
Nous avons donc à faire à un personnage bardé de diplôme universitaire, en position institutionnelle et politique d’expert, mais qui, manifestement, n’a pas eu l’occasion d’expérimenter au quotidien la situation des établissements psychiatriques ou l’expérience du soin. On pourrait donc penser que le caractère circonscrit de son domaine de compétence l’amènerait à une réserve de bon aloi en dehors de son champ de pratique, à savoir la recherche scientifique.
Manifestement, M. Ramus estime néanmoins que ses connaissances scientifiques dans le domaine des sciences cognitives légitiment sa prise de parole par rapport aux soins psychiatriques.
Déjà, cet expert valide les sept premiers points de la charte du collectif des 39, mêlant des « considérations humanistes à l’égard des patients », même s’il semble tiquer sur le terme de « folie » ; évidemment, voici un concept peu scientifique, normé, et définissable en termes de catégorie classificatoire. C’est justement ce que revendique le collectif ; on aura beau protocoliser, moyenner, standardiser, faire des études randomisées, etc. il restera toujours un « résidu », une part de singularité absolument irréductible, la subjectivité inaliénable d’une personne. Le dénier, c’est être hors de la science, dans le fantasme d’une toute-puissance rationalisante et instrumentale. Le reconnaitre n’empêche pas de mener des recherches épistémologiquement fiables, d’intégrer les données épidémiologiques les plus récentes, au contraire. Mais en prenant en compte leurs limites, et leur nécessaire ajustement à une situation individuelle.
Venons-en maintenant au cœur de la critique de M. Ramus concernant « l’imposture des protocoles standardisés pseudo-scientifiques » dénoncée par le collectif. Voici ce qu’en comprend notre expert :
« S’il s’agissait vraiment de rejeter les pseudo-sciences, tout le monde serait d’accord. Mais il s’agit là visiblement (?) de protocoles de soins psychiatriques qui sont justement issus de la médecine fondée sur des preuves, et dont il est tout à fait fallacieux d’affirmer qu’ils sont standardisés et qu’ils nient la singularité de chaque patient. Il faut donc comprendre (?) que ce collectif rejette l’idée même d’une psychiatrie fondée sur des preuves. » (C’est moi qui souligne).
Pour un scientifique, je trouve que M. Ramus tire des conclusions bien hâtives, en interprétant beaucoup les propos de ceux qu’ils cherchent à discréditer. Merci en tout cas pour cette explication de texte neutre et impartiale, sans procès d’intention. Votre probité intellectuelle vous honore, Mr Ramus.
N’étant pas soignant, celui-ci ne réalise peut-être pas à quel point les pratiques cliniques sont effectivement envahis de protocoles gestionnaires et administratifs, qui n’ont rien à voir avec une quelconque scientificité. Il serait cependant intéressant qu’il puisse descendre de son piédestal afin de se pencher sur la réalité concrète des soins en milieu hospitalier et sur les injonctions de plus en plus aberrantes qui pèsent sur les cliniciens, au nom d’une Science instrumentalisée à des fins de management et d’économie. M. Ramus pouvez-vous nous citer quelques exemples précis de protocoles de soins psychiatriques basés sur les preuves et rejetés par les psychiatres ? Quelles avancées spectaculaires ont été réalisées dans le domaine du soin psychiatrique des patients schizophrènes depuis la découverte des neuroleptiques dans les années 50 en dehors des innovations institutionnelles et cliniques que ces mêmes psychiatres essaient de développer au quotidien ?
Les liens que proposent M. Ramus en contre-exemple ont finalement des approches assez différentes, dans le ton et la forme : le « Collectif pour une psychiatrie de progrès » souligne entre autres que la psychiatrie doit « associer les sciences fondamentales, les sciences cliniques, l’épidémiologie, les sciences humaines et sociales » ; que la recherche « doit porter sur une meilleure compréhension des logiques d’émergence des maladies mentales, et, pour une meilleure prévention et précocité des soins, sur la recherche d’indicateurs avancés du diagnostic et du pronostic fonctionnel ». Ce que le collectif des 39 rejetterait ? L’AP4D quant à elle veut permettre au patient de « prendre pleinement sa place dans son environnement social, familial, scolaire et professionnel » et « soutenir les pratiques fondées sur des preuves en psychopathologie du développement de l’enfance à l’âge adulte, par le soutien au développement des connaissances ». Là aussi, je ne vois pas ce qui irait à l’encontre de la démarche du collectif des 39, ou en tout cas ce qui entraverait la possibilité d’échanges respectueux, même si parfois contradictoires, ayant pour finalité l’amélioration et la qualité des soins.
De façon contrastée, le « Kollectif du 7 janvier » constitue au contraire une tribune extrêmement virulente et dogmatique vis-à-vis de la prise en charge de l’autisme, au sein de laquelle M. Ramus lui-même s’exprime avec véhémence, dénonçant par exemple « les conflits d’intérêts massifs des psychiatres psychanalystes qui vivent des subsides de l’état et de l’assurance-maladie, tout en continuant à revendiquer des pratiques sans validité scientifique connue et sans efficacité éprouvée, en pleine contradiction avec le code de déontologie médicale ».
Il faut dire qu’il assène des arguments chocs, tels que « l’histoire a amplement montré que l’immense majorité des médecins peut avoir tort de persister dans certaines pratiques (la saignée pendant 2000 ans) ».
L’idée étant de discréditer toute expérience individuelle, toute prise en compte des pratiques et de la clinique comme un biais cognitif interdisant d’en extraire la moindre validité – je n’interprète pas, c’est ce que M. Ramus revendique sans ambiguïté. Pour ce chercheur, il n’y a donc aucun enseignement à tirer de la place des acteurs, de ceux qui soignent, éduquent, enseignent. Tous ceux-là ont forcément tort, du fait de la distorsion de leur perception. Par contre M. Ramus, lui, peut prétendre connaitre ce qui est vrai, sans avoir jamais exercé.
Cependant, s’il y a les preuves statistiques, il y a aussi l’épreuve de réalité…
L’humilité et la réserve apparaissent à nouveau comme des qualités indéniables de M. Ramus quand il interprète les intentions des autres avec tant de modération et honnêteté : « Leurs revendications doivent être prises pour ce qu’elles sont : des revendications purement corporatistes, visant à pouvoir perpétuer ad vitam les pratiques du passé, sans jamais avoir à les mettre à jour en fonction des connaissances scientifiques nouvelles, et sans jamais avoir à rendre de compte en contrepartie du financement public. De telles revendications sont totalement inacceptables, à la fois pour les familles d’enfants autistes, pour les contribuables et cotisants à l’assurance-maladie, et pour les gouvernants responsables de la santé publique. » Rien que ça !
Voilà maintenant l’autre point de la charte du collectif des 39 qui, d’après M. Ramus, en fait un mouvement réactionnaire cherchant à maintenir ses privilèges, à savoir la dénonciation de « la mainmise de l’appareil technico gestionnaire tentant d’annihiler, de nier et d’écraser la dimension créative et inventive de tout processus de soin ».
Et voici donc l’explication de texte de M. Ramus – heureusement qu’il est là pour lire entre les lignes et nous apporter les lumières de la science : « Il faut ici comprendre que les membres de ce collectif exigent de conserver le privilège exorbitant de dépenser l’argent public sans jamais devoir rendre de comptes sur la nature et l’efficacité de leurs pratiques. »
Je m’autoriserais, en revendiquant le fait qu’il s’agit là de mon interprétation personnelle, à qualifier d’indécente et de diffamatoire ce type d’affirmation. M. Ramus, je vous invite à nouveau à quitter votre position de surplomb hors-sol, à laisser votre laboratoire et à aller vous rendre compte par vous-même de ce qui se passe dans des services de psychiatrie à l’agonie, en sous-effectif humain chronique, soumis à des exigences délirantes de rentabilité, avec un manque évident de places et de structures adaptées… De constater les terribles dérives que favorisent cette déliquescence (mesures coercitives, contention, soins indigents, etc.).
Je vous recommande également de visiter les lucratiques cliniques psychiatriques qui proposent des prescriptions standardisées de six ou sept psychotropes dès l’admission, ou font pratiquer des sismothérapies à la chaîne par souci de profit en termes de tarification à l’acte. J’espère que vous en serez indigné et que vous militerez alors pour que des moyens conséquents soient redistribués en fonction des priorités réelles de santé publique et de décence des soins. Des abus ou des négligences ont sans doute pu avoir lieu, et peuvent encore exister, c’est vrai ; mais peut-on ainsi généraliser des situations très minoritaires pour en tirer de telles généralités, et accuser la psychiatrie publique de gaspiller des moyens collectifs, alors même qu’en termes de financement il s’agit d’un secteur sacrifié des politiques de santé depuis des décennies ?
M. Ramus s’insurge également que le collectif des 39 ose défendre « un enseignement reposant en particulier sur la psychopathologie ». Car, heureusement, notre scientifique sait percevoir les intentions retorses et perverses, il n’est pas dupe : « la psychopathologie est aussi un nom de code pour la psychanalyse lorsqu’elle ne veut pas dire son nom ». Vous avez débusqué la bête sans frémir, merci…
La conclusion s’impose donc, irréfutable, fondée sur les preuves : « Derrière un paravent de bonnes intentions humanistes, ce collectif est donc aussi un syndicat corporatiste défendant la prétention d’une partie des psychiatres et psychologues français à faire strictement ce que bon leur semble avec leurs patients (en particulier pratiquer la psychanalyse), sans avoir à prendre en compte ni les connaissances scientifiques, ni les résultats des essais cliniques évaluant l’efficacité des pratiques psychiatriques, ni le droit des patients à bénéficier d’une psychiatrie fondée sur des preuves, ni celui des cotisants et contribuables à savoir si leur argent est dépensé de manière optimale. » Incroyable !
Par ailleurs, en fin clinicien qu’il est sans doute, M. Ramus repère subtilement les tendances persécutives et complotistes derrière toutes ces dénonciations de la situation de la psychiatrie, en décryptant avec perspicacité et humour une « fixation (à coup sûr « sadico-anale ») sur la terreur totalitaire » dès qu’il s’agit de prendre en compte l’histoire de nos pratiques et leurs zones d’obscurité. Que de passéisme et de conservatisme. Oublions toute antériorité et allons de l’avant, en marche, c’est ça le progrès !
M. Ramus ironise ensuite quant à l’indignation de certains confrères en rapport avec un positionnement de plus en plus rigides de l’ARS vis-à-vis de la formation des soignants, en terme notamment de refus de financements, dès lors que ces enseignements « ne s’inscrivent pas dans les orientations “stratégiques“ des pôles ou des Directions des soins. Ce qui se met actuellement en place, ne touche pas que les formations se référant à la psychanalyse ou à la psychothérapie institutionnelle, mais toutes les formations qui ne rentrent pas dans le cadre des protocoles. Cette “police de la pensée est d’autant plus inquiétante qu’elle se couple à une réduction des moyens que l’on nous annonce chaque jour plus grave : aux dernières nouvelles 23 milliards en 3 ans sur la santé et la protection sociale ! »
Oui, oui, c’est bien le collectif des 39 qui a utilisé cette terminologie de « police de pensée » en premier. En tant que justicier, M. Ramus peut alors s’en donner à cœur joie et dénoncer « la reductio ad Orwellium » ou encore « la rhétorique paranoïaque et geignarde ». Et puis tout ce gaspillage de fonds publics, cela a l’air de vraiment l’obséder. Toutes ces gabegies, cet argent qui abreuve les hôpitaux, et ces psychiatres qui s’en bâfrent.
Un dernier petit conseil : Allez donc en parler sur le terrain de vos constats irréfutables, avec ceux qui ont les mains dans la souffrance au quotidien ; allez professer votre savoir et vos jugements à ceux qui se battent pour soulager la douleur d’autrui, allez leur affirmer à quel point ils volent le contribuable, instrumentalisent leurs patients et méprisent le code de déontologie médicale….
Vous serez peut-être surpris d’entendre le récit de leur expérience et de leur engagement, et de toucher à une réalité qui n’apparait peut-être pas dans PubMed – site de référencement des publications scientifiques. Cela n’aura sans doute aucune légitimité pour vous, car l’expérience et le vécu ne peuvent être que biaisées. Vous leur direz alors où se situe la vérité.
M. Ramus, je ne jugerai pas votre travail scientifique, n’ayant sans doute pas les compétences requises. Mais je permets de vous dire que votre animosité et votre ressentiment ne me semblent pas garantir l’objectivité de vos prises de position, et n’honorent pas l’institution publique de recherche où vous exercez (le CNRS). Vous traquez les biais cognitifs. Ne pensez-vous pas en être contaminé ?
Vous qui prétendez juger par les faits, voilà ce que vous pouvez affirmer, sans aucune vergogne, lors d’un entretien publié dans la revue « le Cercle Psy » : « Il y a une espèce de terrorisme des psychanalystes qui fait que les autres ont peur de parler ouvertement » – sauf vous et votre courage évidemment. Et – je cite intégralement cet extrait car nous sommes proches d’une affirmation délirante – « prendre position publiquement contre la psychanalyse est impensable pour 99 % des psychiatres. Ceux qui pratiquent des bilans dans des centres de ressource autisme voient des enfants se présenter après des années d’errance diagnostique dans un institut médico-éducatif ou un centre d’action médico-sociale précoce, où les psychiatres n’ont jamais offert de diagnostic, ou en ont donné un inapproprié. De nouveaux psychiatres corrigent donc le mauvais diagnostic, réorientent les prises en charge, font des recommandations, mais ils sont obligés de conserver des relations relativement bonnes avec leurs confrères de toutes obédiences, de manière à assurer un lien entre les différents lieux de prise en charge et faire passer des messages vers les équipes thérapeutiques. Il leur faut donc éviter de se fâcher avec leurs collègues, pour préserver des solutions d’accueil pour les enfants. » Je vous renvoie à un billet précédent de ce blog : « La tour d’ivoire hospitalo-universitaire » afin que vous puissiez faire le parallèle.
Dans le paradigme scientifique de ce chercheur, tout ce qui n’est pas démontré statistiquement, n’existe pas, ou est en tout cas infiltré de biais et d’illusion ; ainsi, par exemple, puisque « aucune donnée connue ne permet de mettre en cause l’environnement psycho-social de l’enfant » dans le développement de l’autisme, c’est que l’environnement psycho-social n’intervient pas. Circulez !
Donc, si on suit le raisonnement de M. Ramus, les manifestations d’allure autistiques de Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron étudié par le Dr Itard, ne seraient pas corrélés à son abandon ni aux maltraitances subies ni à sa désocialisation, mais uniquement à son patrimoine génétique. Les tableaux d’hospitalisme sévère avec déficience et traits autistiques observés dans les institutions après-guerre n’auraient aucun lien avec la déprivation relationnelle et affective. Puisque cela n’est pas prouvé, cela n’existe pas.
Un peu de bon sens ne nuit pas toujours à la science…
La médecine fondée sur les preuves (Evidence Based Medecine ou EBM) que revendique M. Ramus consiste à intégrer de façon systématique et protocolisée les données externes issues de recherches statistiquement fiables, de façon à éliminer tous les fondements non validés de la pratique clinique. Dans l’intention, cela parait évidemment louable. Cependant, dans les faits, les résultats ne sont pas forcément à la hauteur des ambitions des promoteurs de cette méthode. De plus, dans le champ de la pratique médicale, et plus particulièrement psychiatrique, des réserves importantes doivent même être formulées, tant sur le plan épistémologique et méthodologique que des applications cliniques, au niveau pratique et éthique.
De fait, une approche strictement factuelle de la clinique, s’appuyant sur des modèles statistiques, prend uniquement en compte un point de vue populationnel et tend ainsi à effacer la réalité du sujet souffrant. Par ailleurs, la méthodologie spécifique de l’EBM (à savoir l’établissement de niveaux de preuve à partir d’études randomisées) ne peut pas s’appliquer à toutes les interventions thérapeutiques, et néglige volontairement toutes les données contextuelles, les dimensions sociales, environnementales, relationnelles, etc. Cependant, ces éléments « extérieurs » et parasites dans le cadre d’une étude, influence de manière décisive la clinique réelle. Ainsi, dans sa pratique, un médecin doit toujours interpréter la singularité de l’expression symptomatique d’une maladie pour un patient individualisé ; il ne se trouve pas confronté à tableau clinique, mais à son mode de présentation chez une personne.
Il convient également ne pas fétichiser les données de la recherche scientifique ; celles-ci sont par essence provisoires, réfutables, sujettes à controverses et remaniements perpétuels. Un praticien se doit donc d’exercer un devoir de réserve, un esprit critique, et maintenir un certain bon sens, en faisant appel à son expérience et à son intuition (obscurantisme ?). Un médecin a la responsabilité de proposer une décision à partir d’un jugement clinique, qui doit être le plus informé possible – même si parfois c’est dans l’urgence que cela se joue… Dès lors l’instauration de protocoles peut aller à l’encontre de cette posture éthique en annihilant l’implication personnelle et l’autonomie, tant du soignant que du patient. De surcroit, il faut reconnaitre que les recommandations heuristiques basées sur des niveaux de preuve suffisants sont finalement assez rares en pratique quotidienne. Par exemple, l’EBM est un outil très mal adapté par rapport à la multimorbidité, à l’intrication de risques psycho-sociaux, c’est-à-dire à la réalité de la majorité des patients, dont des mesures normées viennent oblitérer la singulière complexité.
Par ailleurs, les conditions mêmes de production de ces preuves peuvent et doivent être questionnées. L’évaluation par les pairs prônés par cette méthodologie tend effectivement à créer un entre-soi problématique, des collusions et des conflits d’intérêts non négligeables, ainsi qu’une position d’hégémonie : ce sont toujours les mêmes revues, constituées de chercheurs de même orientation, qui définissent les « bons critères de publication » et la validité de telle ou telle recherche, rejetant toute autre approche (études de cas, approches qualitatives, prise en compte de données historiques, interdisciplinarité, sociologie de la science, etc.). Ainsi, M. Ramus peut critiquer une étude sur le seul fait qu’elle ne soit pas publiée dans une revue anglo-saxonne à impact factor élevé, alors même que les comités scientifiques de ces mêmes revues n’accepteraient jamais une recherche hétérodoxe par rapport à leur ligne éditoriale, indépendamment de tout critère de scientificité. Il est maintenant avéré que certaines pressions, exercées notamment par l’industrie pharmaceutique, contribuent à sélectionner les recherches, à contrôler et à neutraliser les résultats, surtout quand ils sont négatifs par rapport à leurs intérêts. A contrario, la publication des recherches qui aboutissent à des résultats positifs concernant tel ou tel molécule ou dispositif est systématiquement soutenue, afin de créer une masse critique d’articles venant consolider la crédibilité du « produit ». Ne parlons pas des pratiques d’intimidation émanant de laboratoires visant à « neutraliser » ou « discréditer » les chercheurs dont les résultats s’avèreraient critiques à l’égard des attendus.
Au final, il apparait donc que l’EBM, en dépit de sa revendication de neutralité, s’inscrit dans un champ institutionnel, politique et financier infiltré de conflits d’intérêts, et dans lequel on observe la mainmise d’importantes stratégies corporatives déployées à chaque étape de cette économie de la connaissance, dont il est difficile de se déprendre tant les moyens investis sont à la fois puissants et diffus. Les laboratoires de recherche ou les grands groupes pharmaceutiques définissent en effet des priorités en termes de pathologies rentables et conditionnent complètement la recherche au marché qu’elles y associent. Au sein de ce champ de la santé très lucratif et concurrentiel, les effets statistiques ont ainsi tendance à se trouver surestimés, avec un glissement du gain clinique réel vers l’effet statistiquement significatif.
En outre, l’EBM tend à produire une suraccumulation de données très éparses et parfois incohérentes, ce qui tend à brouiller la possibilité de les prendre en compte dans un exercice clinique concret. Trop de chiffres, de résultats, de publications, dispersent l’information, créent du bruit, ce qui peut même amener à une certaine stagnation de l’innovation clinique ou thérapeutique.
D’un point de vue épistémologique et heuristique, certaines recommandations vont donc dans le sens de prendre davantage en compte les éléments individualisés de tel ou tel patient. D’un point de vue éthique, il s’agit également de favoriser le colloque singulier entre un clinicien et son patient, d’intégrer les enjeux existentiels de celui-ci s’en l’enfermer dans une norme statistique établie a priori.
En ce qui concerne le domaine du soin psychique, l’application de la méthodologie de l’EBM s’avère encore plus complexe et litigieuse. De fait, il parait illusoire de vouloir standardiser l’évaluation d’une psychothérapie longue d’inspiration analytique, visant à des remaniements existentiels profonds, contrairement à certaines thérapies courtes centrées sur une manifestation symptomatique circonscrite. Ce qui ne revient pas à dire que ces thérapies seraient les seules à être efficaces, car elles auraient des niveaux de preuve statistiquement significatifs. L’évaluation ne peut être de même nature, sur le plan clinique et méthodologique, et dire qu’une pratique est inefficace simplement parce qu’elle ne s’intègre pas dans un protocole statistique univoque et monolithique, c’est faire preuve de rigidité voire de mauvaise foi. Il faut évidemment évaluer les psychothérapies et les soins psychiques, avec des critères cliniques, en prenant en compte des éléments existentiels de réalité, etc. Cependant, il ne pourra jamais être affirmé définitivement que telle ou telle évolution est à rapporter à l’action spécifique de la prise en charge, ou à d’autres éléments externes. Car le réel ne pourra jamais s’inscrire totalement dans un protocole… On peut le déplorer ou finalement trouver cela plutôt rassurant.
Pour conclure ce (trop) long billet, je voudrais évoquer rapidement le type de méthodes comportementalistes (ABA) que M. Ramus promeut sans doute dans la prise en charge de l’autisme puisqu’elles sont mises en avant par la Haute Autorité de santé et l’ANESM, avec une présomption scientifique d’efficacité.
Tout d’abord, l’étude princeps de Lovass qui avait permis d’objectiver 47 % de résultats positifs avec la méthodologie ABA a depuis largement été remise en question d’un point de vue scientifique. Par ailleurs, l’introduction de ces protocoles sur des structures expérimentales en France permet maintenant d’en apprécier les résultats réels après plusieurs années de recul. Entre la théorie et la pratique, le gouffre parait alors abyssal : sur 578 enfants pris en charge, seuls 19 auraient quitté ces établissements dans des conditions favorables, telles que celles rapportées par Lovass, à avoir une réintégration scolaire normalisée. En revanche, le coût de fonctionnement de ces prises en charge s’avère bien plus élevé que celui des structures médico-sociales classiques, du fait de l’intensité du taux d’encadrement, pour une efficacité clinique contestable. Pourtant, en termes de logique de parcours, ce modèle d’intervention ne pourrait être tenable cliniquement et financièrement que si l’accompagnement intensif pour un même enfant amenait à une orientation ultérieure dans des délais raisonnables.
De surcroit, les procédures ABA mises en place dans ces établissements ont à plusieurs reprises attiré l’attention des pouvoirs publics sur des suspicions de maltraitance, notamment sur le SESSAD Ecla à Roubaix, ou sur l’IME Camus de Villeneuve d’Asq.
En effet, la rigidité des procédures de redressement comportemental peut dériver vers d’authentiques conduites punitives. De plus, le caractère extrêmement répétitif et automatisé de ces protocoles est également susceptible de conduite à un épuisement de l’enfant comme des intervenants, à une forme d’assèchement de la relation. La méthode est néanmoins décrite comme infaillible et, selon ces promoteurs, seul un facteur humain pourrait expliquer des résultats insuffisants – ce qui peut être vécu comme terriblement culpabilisant par les intervenants.
Sur l’IME Camus, Mme Vinca Rivière, sa fondatrice, revendique l’utilisation de chocs électriques aversifs pour éteindre les comportements inappropriés des enfants, conformément à ce que pratiquait Ivar Lovass, le pionnier de la méthode ABA. « Ce qu’on appelle “choc électrique”, on le présente en formation en faisant sucer une pile de 9 volts : ça picote la langue. Et ça suffit à changer un comportement, je l’ai vu en Hollande, et l’efficacité en est démontrée depuis les années 50. La personne au comportement inapproprié porte en permanence à la taille une ceinture reliée à un émetteur placé sur sa cuisse. L’éducateur actionne le dispositif grâce à sa télécommande dès qu’elle émet le comportement. »
Curieusement, il y a peu de communication sur ce genre de pratiques, alors même que les perspectives psychanalytiques restent absolument diabolisées à partir d’écrits mal contextualisés ou de pratiques très anachroniques, qui ont d’ailleurs justifié une légitime réprobation et des évolutions manifestes du positionnement des psychanalystes depuis des décennies. Soyons clairs, je ne cherche pas à remettre en cause ces approches comportementalistes en pointant certaines dérives ou certains excès marginaux. Ces prise en charge (avec également des programmes comme Denver, ou TEACCH) peuvent être tout à fait pertinentes, à partir du moment où elles ne revendiquent pas leur exclusivité et acceptent de s’intriquer avec d’autres types d’abords. Car, c’est la complémentarité, la pluridimensionnalité, la singularité et l’échange qui peuvent donner un sens à un projet thérapeutique global.
M. Ramus, je vous assure, il est parfois intéressant de s’intéresser à la réalité des pratiques et des situations cliniques, de s’extraire des présupposés ou des matrices statistiques, et de garantir « certaines considérations humanistes » à l’égard de nos interventions.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

« Les Saumons », bulletin de l’association, édition de février 2025

« Les Saumons », bulletin de l’association, édition de décembre 2024

« Les Saumons », bulletin de l’association, édition d’octobre 2024








