La pédopsychiatrie au banc des accusés 1 : La critique des « experts »
La pédopsychiatrie suscite des critiques venant d’une « nouvelle antipsychiatrie ». Docteur BB y répond.
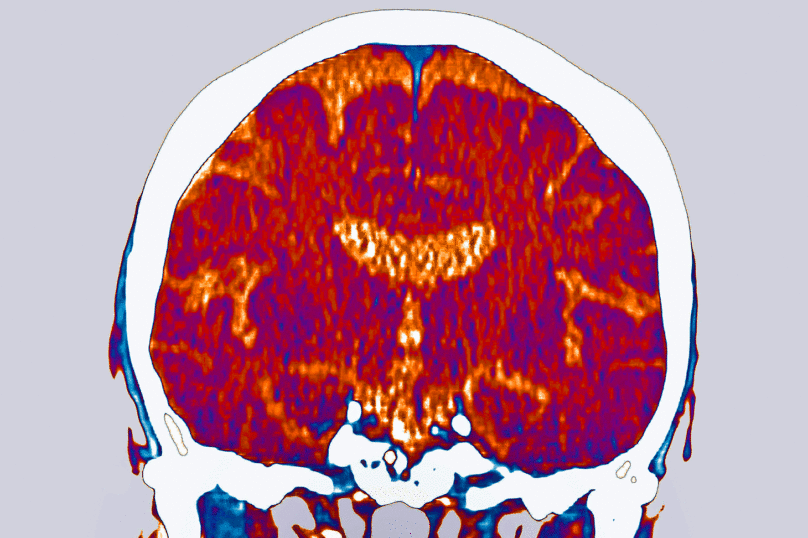
La pédopsychiatrie publique a mauvaise presse, à la fois dans les représentations collectives mais aussi au niveau du discours officiel des « experts » administrateurs ou de certains gouvernants, qui n’ont de cesse d’attaquer idéologiquement nos pratiques, tout en détruisant de façon systématique nos capacité à répondre aux missions qui nous sont dévolues ; de fait, qui veut tuer son chien l’accuse de la rage…
De la proposition déposée par des députés de droite à l’initiative de Daniel Fasquelle, qui voulait contraindre les professionnels de la pédopsychiatrie à appliquer uniquement certaines méthodes thérapeutiques, en passant par le discours sécuritaire de Nicolas Sarkozy, jusqu’aux propos récent de Mme Sophie Cluzel, secrétaire d’État en charge du handicap, (« qu’on arrête de parler de psychiatrie, et qu’on parle vraiment d’une bonne prise en charge, très précoce »), on peut constater que l’ingérence du politique dans le champ des pratiques de soin psychiatrique devient de plus en plus banal. N’est-il pas préoccupant que des politiques puissent ainsi s’arroger le droit de prendre parti dans des débats qui devraient concerner spécifiquement les cliniciens et les scientifiques ?
Par ailleurs, on peut légitimement s’interroger sur les soubassements idéologiques de cette « nouvelle antipsychiatrie ». En effet, ce mouvement, dans les années 1960, était l’expression d’une contestation radicale de la psychiatrie comme institution médicale, comme instrument d’une répression sociale visant à normaliser et à contrôler.
Actuellement, les attaques idéologiques adressées au champ psychiatrique s’en prennent à l’existence même du psychisme et de ses déterminations socio-environnementales, au nom d’un savoir neurodéveloppemental et génétique hégémonique et d’un fantasme scientiste de maîtrise instrumentale absolue. Dès lors, on tend à glisser vers le mental, pour aboutir au neuronal exclusif, ce qui suppose tout simplement d’évacuer l’histoire, le social, l’affectif, le relationnel, la subjectivité, etc. En jetant ainsi le bébé et l’eau du bain, il s’agit finalement de revendiquer un modèle d’humanité très en phase avec l’anthropologie néolibérale : un individu gouverné par ses gènes, désincarné, sans racine ni filiation, sans épaisseur historique ni héritage, au-delà de tout déterminisme social, qui traite de l’information et agit dans un souci de rentabilité de ses investissements.
De surcroit, les revendications de désinstitutionalisation ne s’intègrent plus du tout dans une démarche de contestation des dispositifs de contrôle et d’encadrement. Au contraire, il s’agit désormais de remettre en cause le caractère insuffisamment normé, protocolisé, validé et évaluable du soin, et de prôner des procédures quantifiables, uniformes et absolument « désubjectivantes » ; d’imposer les mêmes catégories nosographiques, réductrices et pseudo-scientifiques, avec des interventions thérapeutiques uniquement rééducatrices sur le mode de la reprogrammation. Au final, ce modèle autorise une forme de financiarisation de la prise en charge et l’intervention de prestataires privés, de « start-up en santé mentale », capables de reproduire les mêmes procédures de façon mécanique. Il s’agit donc de démanteler un service public accueillant des sujets singuliers, avec un projet d’autonomie véritable, pour laisser la place à des intérêts à but lucratif qui auront pour finalité de standardiser des individus sériels, afin de les réintégrer dans la matrice de l’homo oeconomicus.
On est donc passé d’une critique émancipatrice, qui reprochait à la psychiatrie d’enfermer les individus dans des catégories aliénantes et réductrices, à une remise en cause du caractère subjectif, complexe, surdéterminé des approches actuelles, prenant en compte une personne souffrante, dans toute sa globalité, et ne traitant pas uniquement des symptômes comportementaux. Notre époque a l’antipsychiatrie qu’elle mérite…Dès lors, il convient de comprendre véritablement les enjeux de cette désinstitutionalisation revendiquée comme une dé-psychiatrisation libératrice.
Tout d’abord, une institution n’est pas en soi aliénante ou émancipatrice. La façon dont est pensée son organisation et ses finalités peut effectivement favoriser l’autonomie des personnes impliquées, ou au contraire tendre à les enclore et à entretenir une forme de dépendance. Toute institution construit effectivement des modes singuliers de subjectivation, c’est-à-dire des façons d’être, de se comporter, d’interagir, de se socialiser, de ressentir, en charriant certaines représentations implicites de ce qu’est un individu et une société. Pour évaluer le potentiel d’autonomie inhérent à chaque dispositif institutionnel, il convient donc d’appréhender les soubassements idéologiques ou inconscients qui déterminent les orientations profondes de tel ou tel établissement, mais aussi d’envisager l’effectivité des dynamiques d’ouverture, au-delà des principes revendiqués. Car déconstruire les murs ou se polariser sur la personne ne signifie pas forcément libérer…De fait, il parait bien naïf d’envisager les processus actuellement en cours comme une véritable désinstitutionalisation : en réalité, il s’agit davantage de la création de nouvelles formes institutionnelles. Quels en sont alors les déterminations ?
Il s’agit fondamentalement d’une logique de marché, soutenant l’idée d’un individu totalement responsable de lui-même, sans conditions préalables à son autonomie, et qui serait dans une clairvoyance a priori par rapport à ses besoins et à ses désirs, sans avoir besoin d’en passer par une quelconque forme d’altérité, de réciprocité, ou d’inscription collective. Non seulement cette représentation idéologique et anthropologique peut interpeller dans l’absolu, mais elle parait d’autant plus problématique dans le contexte du handicap, ou dans le champ de l’enfance. De surcroit, il s’agit évidemment de favoriser la flexibilité, la précarité, l’actuel, au détriment de la durée et de la continuité. Enfin, la finalité est manifestement de pouvoir à chaque fois chiffrer : pour faire des devis, des appels d’offre, pour mobiliser des prestataires privés sur un temps prédéterminé, pour appliquer un modèle financiarisé de type offre/demande. Dans les intentions, on prône un changement organisationnel qui consisterait à favoriser la souplesse, avec des services à taille humain ou des lignes hiérarchiques plus faibles. Dans le même temps, on regroupe, on mutualise les moyens, on uniformise les modalités d’intervention, on entrave toute créativité à travers l’imposition de protocoles bureaucratiques et de « recommandations », etc. (notamment dans le cadre de la mise en place des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens dans le champ médico-social) ; car c’est la condition préalable pour pouvoir standardiser, quantifier, réduire les dépenses publiques et faire du profit. Ainsi, les conditions d’une véritable marchandisation des troubles de l’enfance sont progressivement en train de se mettre en place. Et la « demande » est d’autant plus là qu’il ne faudrait surtout pas questionner les conditions sociales, anthropologiques, environnementales, qui contribuent à une véritable explosion des diagnostics attribués à des enfants de plus en plus jeunes (troubles attentionnels et dys, troubles du spectre autistique). Au contraire, certains voient cela, de façon naïve ou cynique, comme un véritable progrès, et comme le signe positif de l’influence des neurosciences, qui permettraient un repérage plus précoce, sans avoir à se questionner sur nos responsabilités collectives vis-à-vis du caractère épidémique de ces syndromes….
Au fond, le mouvement militant de désinstitutionalisation initié dans les années 1960 a été littéralement récupéré par les gestionnaires pour justifier la condamnation de tous les dispositifs de soin, la réduction des moyens, la fermeture des lits d’hospitalisation, etc., avec en plus de bénéfice d’être progressiste et d’aller dans le sens du vent, en surfant sur le ressentiment à l’égard des « psys ». Peu importe la situation des laissés-pour-compte, des malades mentaux sur le trottoir ou en prison, de toute façon, ils ne rentrent pas dans les statistiques officielles. Afin de favoriser le recours à des prestataires privés, il convenait au préalable de disqualifier les pratiques de service public –en les empêchant notamment de pouvoir exercer correctement –, et de survaloriser au contraire certaines méthodes exerçant un travail de lobbying massif, avec des intérêts financiers importants. De plus en plus, on s’oriente donc vers un modèle de financement à destination des personnes –lesquelles seront « libres » de faire leurs choix sur le marché concurrentiel de la souffrance psychique –, ce qui suppose auparavant un démantèlement des institutions publiques. Comme le soulignait Stéphane Barbas à l’occasion d’une tribune parue dans L’Humanité, « l’avenir de la pédopsychiatrie dépend de celui de la protection sociale. Les polémiques sur l’autisme ne sont pas nouvelles, elles ressurgissent quand la protection sociale et l’hôpital public sont plus que jamais dans le collimateur de la politique libérale ».
De fait, la volonté délibérer de livrer le champ pédopsychiatrique à l’appétit de certains intérêts privés doit nécessairement se préparer par une déqualification systématique des pratiques, par une réduction massive des moyens effectifs, et par une remise en cause concomitante du secteur public, de la protection sociale et des politiques visant à tisser du commun, sous couvert de progrès et d’émancipation.
Les gestionnaires se saisissent évidemment des attaques récurrentes adressées à la psychiatrie pour mener leur gouvernance d’austérité budgétaire, avec des perspectives d’économie sur de très courtes échéances. Car l’esprit néolibéral glorifie l’instant au détriment du durable, et les effets à long terme de telles politiques sont donc systématiquement occultés…
Il faut cependant conditionner les esprits à ces évolutions, en relayant médiatiquement certaines contre-vérités, répétées ad nauseam. Car, pour préparer ce renversement de paradigme, il parait essentiel de faire infuser au préalable certaines représentations dans l’opinion publique, d’orienter les demandes collectives et individuelles, en instrumentalisant notamment la détresse des familles, sans aucune vergogne. Ainsi, on en arrive à l’idée pure et simple qu’il faudrait carrément éliminer ces pédopsychiatres incompétents, et que tout pourra alors fonctionner comme sur des roulettes. En effet, on pourrait presque en arriver à penser que ce sont finalement tous ces cliniciens intervenant dans le champ de l’enfance qui seraient responsables de la souffrance de leurs « usagers ». Étrange renversement…
Certains experts scientifiques jouent ce rôle de sape à la perfection, avec une telle fougue qu’on les croirait investi d’un véritable sacerdoce ; voici par exemple les propos que peut tenir notre ami Franck Ramus, membre du conseil scientifique de l’Éducation nationale, sur son blog :
L’idée d’orienter les troubles dys de manière privilégiée vers la pédopsychiatrie est inacceptable, quand on sait que cette spécialité, sous sa forme psychanalytique encore prédominante, concentre les plaintes des familles pour refus de diagnostic, retard au diagnostic, diagnostic erroné (dysharmonie, troubles de l’attachement…) et mise en accusation inappropriée des parents. Les CMPP se sont malheureusement largement illustrés dans cette forme d’incompétence. Si le gouvernement a vraiment à cœur la qualité des soins pour les enfants et des adolescents, il doit écarter les CMPP de tout réseau de prise en charge des troubles dys.
Pourtant, aujourd’hui encore, on compte de nombreux enfants « dys » en situation d’errance diagnostique et/ou thérapeutique, notamment dans les Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP). Ces enfants sont souvent pris en charge suivant une grille de lecture exclusivement psychanalytique, sans diagnostic pluridisciplinaire, sans rééducation adaptée, à l’encontre de toutes les recommandations scientifiques et médicales, françaises et internationales. Lorsqu’ils sont finalement diagnostiqués et pris en charge d’une manière adéquate, il est souvent bien tard, beaucoup d’années de scolarité ont été perdues, et au fil des années de nombreuses difficultés se sont superposées au trouble initial : échec scolaire, perte d’estime de soi, troubles psychologiques, conflits familiaux…
Longue citation, qui vaut cependant le détour…En effet, M. Ramus, qui prétend être un scientifique ne s’appuyant que sur des statistiques fiables et éprouvées, énonce ici des réalités non étayées, diffamatoires et méprisantes, sans citer ses sources, au-delà de ses propres projections chargées d’animosité. Par ailleurs, on voit bien l’affirmation du modèle pathologique ultra-simpliste et réducteur de ce genre de chercheur, peu enclins à s’interroger sur les déterminants épistémologiques de leurs conceptions : un trouble primaire d’origine exclusivement génétique altérant des modules cérébraux de traitement cognitif, sur lequel se grefferont éventuellement des comorbidités secondaires (anxiété, dépression, difficultés relationnelles, etc.), du fait notamment de la mauvaise prise en charge des pédopsychiatres, qui pourtant bénéficient de tellement de moyens à leur disposition…
Ce type de modèle univoque et réductionniste évacue d’emblée les dynamiques socio-historiques dans l’étiologie de ces troubles, en dépit des recherches récentes de certains sociologues (« La médicalisation de l’échec scolaire » de Stanislas Morel, « À l’école des dyslexiques » de Sandrine Garcia, « La petite noblesse de l’intelligence » de Wilfried Lignier, entre autres). Ces travaux soulignent la dimension en partie socialement construite de ces catégories, les évolutions pédagogiques et éducatives qui peuvent aussi contribuer à les expliquer, les enjeux identitaires et les stratégies de récupération autour de ces diagnostics, etc. La prise en compte de ces dimensions autoriserait éventuellement des stratégies de prévention primaire, ce qui ne parait évidemment pas pertinent si on estime que tout est programmé génétiquement – avec d’ailleurs une conception très datée des mécanismes de régulation moléculaires et génétiques au niveau développemental. Ainsi, ce genre de conception mécaniciste entrave toute intervention prophylactique, toute implication politique…La dimension transdisciplinaire de la pédopsychiatrie permet au contraire de maintenir une articulation dialectique entre différents modèles, des sciences sociales aux neurosciences, susceptible de laisser une place à la complexité irréductible et singulière d’un enfant, sans l’enfermer dans une catégorie nosographique.
Outre le positionnement condescendant d’un expert hors-sol, conseillant les politiciens sans avoir jamais assuré de suivi clinique – n’y peut être franchi la porte d’un CMPP –, les répercussions de ce genre de discours posent problème car ces accusations infondées s’infiltrent progressivement dans les esprits. Les familles se trouvent ainsi instrumentalisées et servent alors de fer de lance pour justifier le démantèlement des dispositifs publics, en faveur des « bons intervenants », validés scientifiquement, sans aucun conflit d’intérêt, cela va de soi…
Dès lors, il sera intéressant d’appréhender dans un prochain billet la façon dont les familles peuvent être imprégnées de ces spoliations, en analysant les griefs qu’elles adressent à la pédopsychiatrie. Néanmoins, ceci ne nous dédouanera pas de la nécessité de faire notre propre autocritique…
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

« Les Saumons », bulletin de l’association, édition de février 2025

« Les Saumons », bulletin de l’association, édition de décembre 2024

« Les Saumons », bulletin de l’association, édition d’octobre 2024








